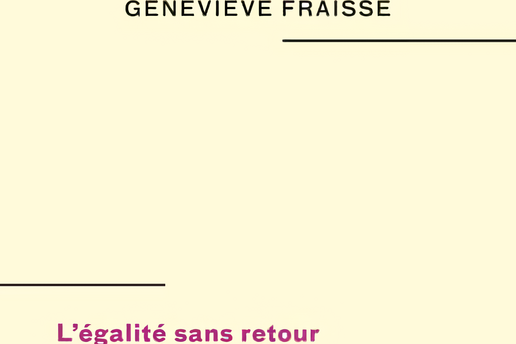L’argent, ce dieu moderne universel, a-t-il participé à la dissolution des liens communautaires des sociétés ? A-t-il, en pénétrant jusque dans les sphères les plus personnelles des relations humaines, transformé la famille en « entreprise » et l’amitié en « marché » ? Ces interrogations, qui occupaient philosophes et sociologues au début du XXe siècle, ont donné lieu à des réponses tranchées. Émile Durkheim, Ferdinand Tönnies et Max Weber considéraient la monétarisation des rapports comme l’un des phénomènes importants accompagnant l’individualisme moderne. Georg Simmel (1), lui, allait plus loin, attribuant spécifiquement à l’argent le pouvoir de rationaliser et de dépersonnaliser les liens les plus intimes. Cependant, il ne s’agissait pas seulement de destruction, puisqu’en même temps l’argent apportait la liberté d’échanger, grâce à sa propriété d’équivalent universel de toutes choses, ce que les économistes appellent sa « neutralité ».
L’argent en dehors de la sphère marchande
Ces thèses, longtemps tenues pour acquises, sont aujourd’hui remises sur le métier par des observateurs attentifs de la manière dont l’argent circule dans les rapports que nous entretenons, au quotidien, avec nos proches ou avec des inconnus, en dehors de la sphère marchande.
Pour un banquier rompu aux techniques de la finance, ces manières peuvent sembler déroutantes. Ainsi, qui d’entre nous n’a, dans sa jeunesse au moins, conservé une tirelire de pièces jaunes, dans le but éventuellement de la casser à Noël ? Pourquoi ne pas y mettre des billets ? Cette démarche minimale ouvre vers ce que les spécialistes appellent aujourd’hui le « marquage », dont on constate la présence dans de nombreuses sphères de la vie sociale. Comme le rappellent Damien de Blic et Jeanne Lazarus (2), le fait de séparer matériellement l’argent du ménage de l’argent des sorties au cinéma traduit le fait que toutes les monnaies « ne se valent pas ». Cela peut tenir à la décision des acteurs, mais aussi, plus couramment encore, à la source même de l’argent. Comment expliquer que, par exemple, les gagnants du loto « claquent » avec prodigalité leurs gains, mais pas l’argent de leur salaire ? Pourquoi les prostituées norvégiennes, étudiées par Cecilie Hoigard et Liv Finstad (3), distinguent-elles deux sortes d’argent : celui provenant de leurs activités prostitutives, vite dilapidé en loisirs et objets de luxe, et celui des allocations de mères isolées, soigneusement préservé ? L’argent aurait-il une « odeur » qui le poursuit et l’empêche de circuler librement ?
Dans son étude déjà classique sur l’usage social de l’argent (4), Viviana Zelizer soutient cette thèse. Elle rappelle, par exemple, combien la monétarisation de l’aide charitable fut problématique aux États-Unis, et le reste en grande partie. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les services sociaux et les œuvres caritatives distribuaient aux familles pauvres des aides en nature : nourriture, vêtements, paiement du loyer, etc. Une doctrine différente, cependant, s’imposa : celle de la responsabilisation par l’apprentissage de l’économie domestique. Mais elle se heurtait à l’idée que les nécessiteux, étant des gens imprévoyants et faibles, risquaient de faire mauvais usage de l’argent liquide. Dans les années 1920, on vit donc se généraliser la pratique de l’argent « dédié » : les pauvres recevaient une somme avec des instructions expresses sur l’usage qui devait en être fait, et l’obligation de rendre des comptes. Les agences charitables devinrent donc des organismes de surveillance des dépenses des pauvres. Un homme, rapporte V. Zelizer, se vit reprocher ainsi d’avoir consacré une part de l’aide familiale à l’achat d’un petit chien, une dépense jugée superflue par les inspecteurs des services sociaux.