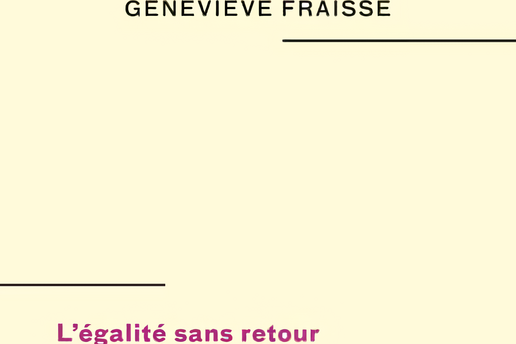Il y a quarante ans exactement, l’Académie française, non sans avoir longuement grincé des dents, reconnaissait qu’une ambassadrice n’était pas forcément l’épouse d’un ambassadeur. Inscrite au Journal officiel, la féminisation des titres et noms de métiers est aujourd’hui la norme au point que plus personne ne pense faire preuve de féminisme échevelé en écrivant « professeure » avec un « e ». La lutte contre le sexisme linguistique a vu d’autres fronts s’ouvrir qui, eux, sont bien actifs : c’est le cas de la fameuse « écriture inclusive », dont certaines composantes jugées un peu trop innovantes soulèvent régulièrement de virulents débats.
L’écriture inclusive, rappelons-le, a pour but de ne pas masquer la présence de femmes dans des collectifs désignés auparavant par des termes masculins. Il y a des moyens classiques d’y parvenir : la double flexion (les étudiants et les étudiantes), la périphrase (la collectivité étudiante), le terme épicène (les élèves). Tout cela passerait bien, excepté un peu de lourdeur, si les réformateurs n’avaient brandi, telle une hache de guerre, l’usage radicalement innovant du point médian (les étudiant·e·s) et des pronoms dits « neutres » (iels, celleux, toustes, etc.). Les académiciens ont à l’époque vu rouge, annonçant « la mort de la langue française » ; un ministre de l’Éducation a pondu une directive en proscrivant l’usage dans les écoles, et pas plus tard qu’en octobre 2023, les sénateurs ont voté un projet de loi interdisant cette pratique dans les documents officiels et contractuels. Programmée pour discussion à l’Assemblée nationale, cette loi pourrait bien être adoptée. Fait exceptionnel, les députés se mêlent rarement de politique linguistique. Ceci expliquant cela, on a vu fleurir à nouveau les communiqués assassins, pro et contra.