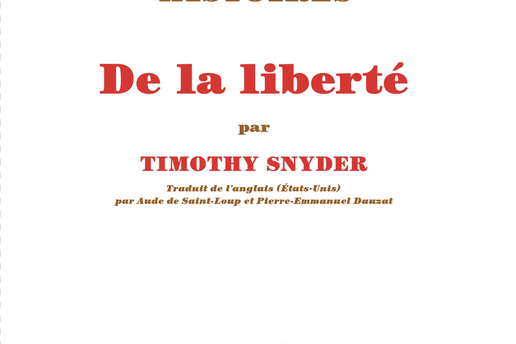Comme il le rapporte lui-même dans ses mémoires, c’est en 1855 que John Stuart Mill (1806-1873), alors qu’il gravissait les marches de l’ancien Capitole de Rome, prit la résolution de rédiger au plus tôt l’ouvrage qui fait de lui, encore de nos jours, l’un des penseurs les plus marquants de la liberté individuelle. Mais son projet était moins inspiré par ce haut lieu de l’histoire antique que par trente années d’activité intellectuelle et politique intense au cœur de la société anglaise, et par les péripéties de sa vie intime.
Né en 1806 à Pentonville, près de Londres, il est le fils aîné de James Mill, un pasteur écossais défroqué de l’église presbytérienne, qui menant de front une carrière de journaliste, d’historien et d’économiste, est devenu un représentant de la Compagnie des Indes orientales en même temps qu’un des piliers de la branche dite « radicale » du parti libéral. Inspiré des Lumières et de son rationalisme, en difficulté avec la religion, avec le principe monarchique, et tout ce qui rappelle la société d’ordre ancien, le libéralisme de James Mill se pose en alternative réformiste à la Révolution française. Promouvoir la prospérité par le libre marché, et assurer la démocratisation du pouvoir par l’extension du suffrage fortement accaparé à l’époque par l’aristocratie anglaise, fait partie de ses grands objectifs. Ses maîtres à penser sont Adam Smith et David Ricardo pour l’économie, et John Locke et Jeremy Bentham pour la philosophie sociale. La doctrine, à la fois morale, juridique et sociale de Bentham est l’utilitarisme, un principe ouvertement laïque, qui affirme que toute action ne se mesure qu’à la quantité de plaisir ou de peine qu’elle procure, à soi-même ou à autrui. En lieu et place des dogmes et interdits religieux ou coutumiers, l’utilitarisme n’en conserve qu’un : celui de ne pas nuire à autrui. Mais, une fois ceci posé, Bentham a aussi peu d’affinité avec l’égalitarisme des sans-culottes, qu’avec les devoirs de charité envers les pauvres proclamés par les doctrines chrétiennes. Sur un plan collectif, la pertinence d’une nouvelle loi, par exemple, s’évalue à sa capacité à augmenter le « bonheur total », qui n’est pas forcément distribué au même degré à tous les individus.
C’est dans cet environnement d’idées, et armé d’une bonne culture des auteurs classiques, que John grandit, sous la férule de son père, de Bentham et de Ricardo, qui sont des amis de la famille. En 1820, il voyage en France et développe un goût durable pour le continent. Parvenant à l’âge de prendre un chemin dans la vie, il n’en entrevoit qu’un seul : devenir un « penseur original », objectif qui n’est envisageable qu’au sein de trois professions : celle de professeur à l’université, de parlementaire ou de journaliste. John Mill n’embrassera aucune d’entre elles : l’athéisme de son père et le refus de toute allégeance à une confession lui barrent la route des deux premières institutions, dominées par l’église anglicane. Quant au journalisme, c’est une voie précaire et inféodée aux partis politiques. En 1823, alors qu’il n’a fréquenté aucune école ni université, Stuart Mill entre, comme son père, au service de la Compagnie des Indes, où il sera chargé, pendant vingt-cinq ans, de rédiger des notes d’information sur la situation en Inde, sans jamais s’y rendre. Cette activité « alimentaire » lui laissera le loisir de participer, par ses écrits et ses prises de paroles, aux débats philosophiques, moraux, sociaux, politiques et économiques qui agitent la Grande-Bretagne et l’Irlande. La question de l’esclavage colonial qui, tendances politiques confondues, divise l’opinion entre partisans du maintien, réformateurs et abolitionnistes : les libéraux sont antiesclavagistes, mais les fers de lance de l’abolition (qui est obtenue en 1833) sont plutôt des évangélistes et des puritains. L’émancipation des catholiques, arrachée par les Irlandais en 1829, est un autre sujet de discorde, qui entame la place accordée à l’Église anglicane en tant que religion d’État : les libéraux, de même que bon nombre d’Églises dissidentes (méthodistes, baptistes, unitariens), ne peuvent que s’en réjouir, même si du chemin reste à faire pour séparer la religion de l’État. Le Royaume-Uni a beau être une monarchie constitutionnelle gouvernée par un Premier ministre, l’accès au parlement est solidement verrouillé par les lois électorales, qui garantissent à l’aristocratie terrienne conservatrice une surreprésentation dans les deux chambres. Les classes « industrieuses » montantes réclament leur réforme, qui ne sera accordée qu’au compte-gouttes, car elle sape l’autorité royale. D’autres grands problèmes agitent aussi la scène des idées : celui du traitement de la pauvreté, et celui de la montée en puissance d’un prolétariat manufacturier supportant de plus en plus mal les conditions de travail et l’insécurité qui lui sont imposées par les entrepreneurs capitalistes. La réponse des conservateurs est le paternalisme : les pauvres et les chômeurs sont accueillis dans des « workhouses », où la survie leur est à peine assurée en échange d’une discipline de fer et d’un travail le plus souvent inutile. Enfin, face aux désordres qui accompagnent les suites de la révolution industrielle, l’urgence de penser de nouvelles lois et d’autres normes morales préoccupe tous ceux qui aspirent à plus de démocratie, mais craignent les effets d’un capitalisme sans frein. Sur ce front, les libéraux sont loin d’être les seuls à se battre : les puritains et d’autres Églises dissidentes proposent un retour à la foi évangélique, tandis que des socialistes de tous bords préconisent des recettes variées pour l’émancipation des classes travailleuses. Sur tous ces sujets, Stuart Mill aura à se prononcer en se faisant tour à tour moraliste, juriste, théoricien politique, économiste et même épistémologue, afin de rappeler que toute assertion doit se fonder sur des considérations empiriques et non sur les évidences de l’intuition.