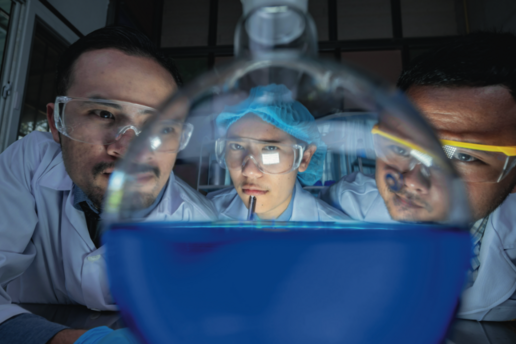Zoom sur : La révolution des techniques
Quels sont les arguments des antivax ?
Zoom sur : Portrait robot de l'antivax covid-19
Zoom sur : Les réseaux sociaux, terreau du soupçon
Le défi de la crise sanitaire : vacciner massivement dans des délais records
Quand est-elle apparue ?
La question est moins simple qu’elle en a l’air. Si le procédé est généralement associé à Louis Pasteur et à la vaccination* 1 contre la rage du jeune Joseph Meister au cours du mois de juillet 1885, on doit considérer le médecin anglais Edward Jenner comme le véritable découvreur de la méthode. Ce dernier inocule la vaccine* 2, une forme bénigne de la variole à un garçonnet de 8 ans, James Phipps, en mai 1796. Mais on peut encore remonter aux expériences menées par Mary Mortley Montagu en 1721 quand elle décide d’appliquer à ses enfants l’inoculation* 3 variolique qu’elle a vu réussir sur la progéniture des familles levantines à Constantinople, ville où elle a séjourné aux côtés de son mari ambassadeur. L. Pasteur, qui a prouvé que les vaccins sont efficaces sur les animaux (choléra des poules, charbon du mouton, etc.), choisit en 1883 de donner au procédé le nom générique de « vaccination » en hommage à E. Jenner et à son invention. Nous utilisons encore ce procédé aujourd’hui.
Une fois que L. Pasteur et ses contemporains ont compris comment atténuer artificiellement la virulence d’un microbe, il devient possible de fabriquer des vaccins contre d’autres maladies. Entre 1885 et 1897, des essais plus ou moins concluants permettent d’élaborer un vaccin contre le choléra, contre la peste et contre la typhoïde.
Après la Première Guerre mondiale, de nouveaux vaccins apparaissent : diphtérie, tuberculose, tétanos, coqueluche, fièvre jaune et typhus. Après la Seconde Guerre mondiale, on vaccine contre la grippe, la poliomyélite, les maladies de l’enfance (rougeole, rubéole, oreillons, varicelle), la méningite, les hépatites A et B, etc.
À partir des années 1950, l’offre vaccinale enfle continûment et les maladies régressent, d’abord dans les pays développés, puis dans les autres en combinaison avec de notables améliorations sanitaires (accès à l’eau potable, traitement des eaux usées, antibiotiques, progrès de la pharmacopée, progrès de la chirurgie, progrès social). Cette évolution s’inscrit dans ce qu’Abdel Omran a nommé en 1971 la « transition épidémiologique » : une diminution de la mortalité par maladies infectieuses et une augmentation des maladies comportementales (ex. tabagisme), d’usure (ex. infarctus du myocarde) et de dégénérescence (ex. maladie d’Alzheimer). Un modèle que l’émergence à la fin des années 1970 du sida et les alertes pandémiques des années 2000 ont contribué à ruiner, en même temps qu’elles mettaient à l’épreuve l’optimisme vaccinal qui avait régné durant ces « Trente Glorieuses médicales ». ↑↑↑
Comment s’est-elle imposée ?
Le vaccin n’est pas un médicament comme les autres. Il constitue d’abord une bizarrerie médicale en tant que « remède prophylactique ». On injecte une substance à un patient sain pour prévenir une maladie qu’il n’aurait peut-être pas contractée. Ce geste nécessite de convaincre et n’a pas l’évidence d’un traitement administré à un individu malade qui supplie qu’on lui vienne en aide.
Pour convaincre, les médecins font appel aux statisticiens. C’est la fameuse balance bénéfice/risque. Puisque le risque de l’accident vaccinal n’est pas nul, il faut démontrer que le risque de mourir de la maladie ou d’être gravement atteint par elle est plus grand. Au 18e siècle, au moment du débat sur l’inoculation variolique, les partisans du remède se mettent à éplucher les registres de mortalité pour comparer les taux avant et après son usage. Le mathématicien Charles Marie de La Condamine résume ces enquêtes par une formule lapidaire : « La nature nous décimait, l’art (médical) nous millésime. » Le constat est un peu optimiste : si la variole est à cette époque mortelle dans 1 cas sur 5 ou 6, l’inoculation rend gravement malade dans 1 cas sur 50 ou 60. Le rapport est donc de 1 à 10 et non de 1 à 100. En outre, Jean Le Rond d’Alembert démontre par des calculs tout aussi savants que la prise de risque individuelle n’est pas réductible au risque collectif, arguant qu’on ne peut comparer le « désespoir d’avoir hâté la mort » (si un accident se produit après l’inoculation) et le malheur de l’avoir « laissé subir » (si par malchance on contracte la variole naturelle).