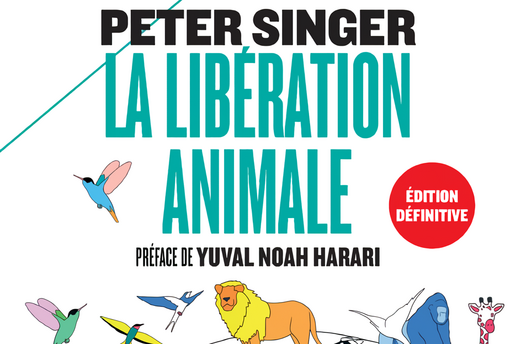Paris, par une matinée d’automne fraîche mais ensoleillée. C’est à quelques pas du cimetière Montparnasse, au siège de son éditeur Albin Michel, que nous rencontrons Richard Sennett, de passage en France pour la sortie de son dernier livre. L’homme a un emploi du temps chargé, mais il nous accorde un peu de son temps pour converser, un art qu’il apprécie particulièrement.
Philosophe et sociologue, R. Sennett est aujourd’hui l’une des principales figures de la critique sociale. Ses analyses s’inspirent des philosophes pragmatiques tels que William James, Charles Peirce ou encore John Dewey. Néanmoins, c’est en lisant La Condition de l’homme moderne (1958) d’Hannah Arendt qu’il forge sa théorie de l’humain, en l’ancrant dans le matériel. Il déjoue ainsi les critiques adressées à son école de pensée dont les réflexions sont parfois jugées trop discursives et abstraites. Pour enrichir l’esprit, il mise sur les expériences que chacun peut réaliser au quotidien, plutôt que sur les connaissances apprises passivement. « Les questions d’identité et de désir ont pris une importance trop grande, explique R. Sennett. Ce que font les gens est plus important que ce qu’ils sont. Voilà ce que je veux montrer : faire, c’est plus important qu’être. » Aujourd’hui, il applique ces principes à la construction des villes. Il plaide pour une éthique de l’urbanisme donnant une large place à l’expérience qu’en font les citadins.
Dans votre dernier ouvrage Bâtir et habiter, vous proposez une éthique qui consiste à « ouvrir » les villes. Pourquoi ?
Aujourd’hui, les villes ont tendance à se fermer. Elles deviennent de plus en plus cloisonnées, ségréguées, divisées en espaces non mixtes. Les gens se regroupent dans des quartiers en fonction de leur classe, de leur ethnicité…
J’ai remarqué les effets dévastateurs des communautés fermées auprès des enfants qui grandissent dans de telles conditions. Ils ne connaissent pas la complexité du monde. Ils ne vivent pas avec des gens de classes sociales différentes, ils ne sont pas confrontés à la diversité sociale. Leur expérience humaine est pauvre, qui a des conséquences psychologiques à long terme. Ces enfants devenus grands ne peuvent pas affronter la complexité du monde.
Les villes présentent aussi un autre problème : leur fonctionnement est devenu mécanique, automatique. On applique des règles standardisées, imposées aux citadins, pour réguler le trafic automobile par exemple. On essaie de tout simplifier, pour avoir une organisation plus claire. Ce n’est pas une solution souhaitable, de mon point de vue. Je pense que la simplification et la standardisation sont nuisibles. Je préfère la complexité.
Pourquoi la complexité est-elle préférable ?
Mon siège philosophique est le pragmatisme. C’est un courant philosophique qui considère que l’expérience prime sur la théorie. Or, les pratiques humaines sont plurielles, extrêmement riches de cette diversité. Prendre conscience de cette complexité, l’expérimenter par des relations humaines variées, enrichit l’esprit et la réflexion personnelle. Cette attitude rend l’individu plus libre et autonome.
De ce point de vue, la ville est particulièrement intéressante car elle concentre une pluralité d’expériences : elle regroupe des personnes fort différentes (jeunes, vieux, immigrés, hommes, femmes, pauvres, riches…) dans un espace qui doit permettre de réaliser une pluralité d’activités (dormir, travailler, se récréer…). Dans mes livres, je poursuis toujours l’objectif de tracer à la fois les problèmes et les possibilités pour y remédier, pour enrichir l’expérience là où d’autres cherchent à simplifier la réalité, au risque de la caricaturer et d’en avoir une vision tronquée. Dans Habiter et bâtir, je ne présente pas une solution unique pour décloisonner les espaces urbains et favoriser la mixité, mais plusieurs.