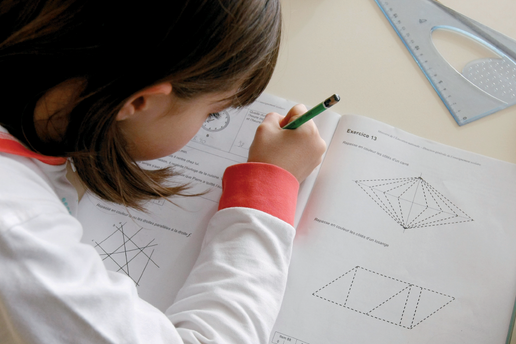Dépasser les frontières qui constituent l'horizon de son groupe d'appartenance pour mieux connaître ce dernier et peser sur son destin, voilà une posture qui ne date pas d'hier. Dès sa naissance, la philosophie politique raisonne en ces termes 1. Que ce soit grâce à Platon ou à Aristote, les Grecs ont tôt réfléchi à l'aide de catégories politiques (tyrannie, oligarchie, démocratie...) qui leur ont permis à la fois de comparer les cités entre elles et de réfléchir sur la meilleure manière de « vivre ensemble ». Lorsque bien plus tard, dans ses célèbres Lettres, Montesquieu se fait persan, il recourt à sa façon à la comparaison internationale : le regard que posent Usbek et ses amis, ces « gens transplantés de si loin », est une arme redoutable pour disséquer avec un humour distancié les moeurs de la société française du début du xviiie siècle. Alexis de Tocqueville fera le choix d'un autre détour encore - celui de l'observation de la démocratie américaine - afin de mettre au jour quelques principes (division des pouvoirs, liberté associative, décentralisation...) qui, aux yeux de l'aristocrate français, peuvent aider son pays à éviter les dérives de la servitude. Quelle qu'en soit la modalité, la confrontation à une réalité autre n'est donc pas une stratégie nouvelle. L'usage méthodique et raisonné du comparatisme est en revanche de facture plus récente. Il est inséparable en fait de l'invention des sciences de l'homme et de la société.
L'invention de la comparaison
Au xixe siècle, comparer devient un gage de connaissance nouveau dans des domaines aussi différents que la grammaire, la littérature, l'anatomie, le droit, la sociologie, etc. 2. Dans Règles de la méthode sociologique (1895), Emile Durkheim prête ainsi à la comparaison les vertus d'une quasi-expérimentation capable d'assurer à la sociologie une véritable assise scientifique. Dans Le Suicide (1897), il ne se lasse pas de confronter moult données statistiques relatives aux régions françaises et à de nombreux pays d'Europe. Pour E. Durkheim, si « on se laisse guider par l'acception reçue, on risque de distinguer ce qui doit être confondu ou de confondre ce qui doit être distingué, de méconnaître ainsi la véritable parenté des choses et, par suite, de se méprendre sur leur nature. On n'explique qu'en comparant 3».
Alors même qu'on la présente souvent comme l'antithèse du positivisme français, la tradition sociologique allemande n'est pas en reste. Max Weber, son représentant le plus célèbre, a systématiquement recours lui aussi à des comparaisons internationales de grande ampleur (avec la Chine, l'Inde, la Rome antique, etc.) afin de fournir des arguments empiriques solides en faveur de la thèse d'une rationalisation spécifique des sociétés occidentales modernes.
Bien qu'ils en soient initialement de grands consommateurs, les sociologues n'ont pas l'apanage de la comparaison internationale. Au xixe siècle, dans le sillon creusé par Marc-Antoine Jullien de Paris 4, les spécialistes d'éducation qui se piquent d'international donnent priorité aux cas de l'Angleterre et de la Prusse (pionniers en matière d'enseignement primaire obligatoire) pour en tirer des leçons qu'ils souhaitent ensuite appliquer à leur pays d'origine.
Les économistes ne rechignent pas non plus à la tâche. Adam Smith et David Ricardo, pour ne citer que les pionniers les plus connus, soupèsent les atouts respectifs des différentes nations afin de comprendre la logique qui structure la division internationale du travail. Les anthropologues recourent également au détour comparatif. Ils montrent ainsi de façon parfois spectaculaire combien, y compris sur des registres que nous avons tendance à penser comme naturels (celui du sexe par exemple 5), nos façons d'être et de penser sont relatives.
La science politique ne fait pas plus exception. Dans un bilan de la discipline au milieu des années 60, Madeleine Grawitz constate que la méthode comparative « est à l'heure actuelle sans doute la plus utilisée par les politologues étudiant les régimes et les institutions, c'est-à-dire surtout par les juristes. Le nombre d'ouvrages de "comparative government" publiés aux Etats-Unis est très grand 6 ».
Pour suggestif qu'il soit, ce tableau impressionniste ne doit pas duper. Si la comparaison internationale s'impose comme un instrument de connaissance commun à de nombreuses sciences sociales, le degré d'intérêt, les enjeux et les méthodes ont en fait beaucoup évolué dans le temps. Au cours du xxe siècle, les années 60 constituent à ce titre un moment privilégié. Nombre de travaux qui font date à l'époque s'inscrivent dans un courant développementiste qui rationalise de façon plus ou moins explicite la supériorité du modèle économique et politique occidental, la voie anglo-saxonne au premier chef 7. Ce travers évolutionniste prend fin au milieu des années 70. Avec les symptômes apparents du déclin de l'hégémonie américaine sur le monde (déclaration d'inconvertibilité du dollar en or en août 1971, conflit indochinois...) s'ouvre un espace d'interrogations beaucoup plus critiques à l'égard des conceptions occidentales de la modernisation.
Des options de méthode variées
Un des moyens salutaires qui aura permis de faire peau neuve en matière de comparaison internationale est une exigence théorique et méthodologique plus soutenue. Dans le bilan qu'il établit à la fin des années 80, Erwin K. Scheuch 8 recense quatre grandes options qui se distinguent par le type d'objectif assigné à la comparaison d'une part et par le statut dévolu par les chercheurs aux contextes sociétaux que l'on considère d'autre part.
- Type 1 : identification d'universaux. Cette stratégie consiste à rendre raison d'un fait social considéré comme universel (le tabou de l'inceste par exemple) et à montrer dans quelle mesure chaque culture ne fait qu'accommoder à sa façon une injonction qui détermine les rapports sociaux de toutes les sociétés humaines connues. Cette stratégie n'est pas étrangère non plus à la pratique des grands organismes internationaux qui, tels l'OCDE ou le BIT, construisent des indicateurs d'emploi, de chômage, d'éducation... destinés à mesurer les performances de différents pays. Utile pour comparer un grand nombre de sociétés, cette manière de faire peut parfois poser problème dès lors que l'on oublie que, d'un pays à l'autre, être travailleur, chômeur, étudiant... renvoie à des représentations et à des réalités extrêmement variées. Il est impossible par exemple de comparer à l'aide d'un unique indicateur la situation des femmes actives françaises à celles de leurs homologues allemandes, tout simplement parce que les modalités d'accès à l'emploi ne sont pas les mêmes, que les services de garde d'enfants et les soutiens de la parentèle ne sont pas comparables, etc. A cela s'ajoutent de nombreuses difficultés méthodologiques (plans de sondage différents, problèmes de traduction des questionnaires...) qui ne facilitent pas la tâche. C'est ainsi au nom de telles contingences que la France s'est retirée de l'enquête effectuée en 1994 par Statistique Canada et l'OCDE afin de mesurer les capacités de lecture et d'écriture des adultes dans un groupe de huit pays. Outre des problèmes d'échantillonnage, il est apparu notamment que pour un tiers des items, et en raison spécifiquement de problèmes de traduction, la difficulté était plus grande dans la version française du questionnaire que dans l'original anglo-saxon, ce qui pouvait pour partie expliquer le médiocre classement des Français en queue de peloton derrière le Canada, les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse 9.