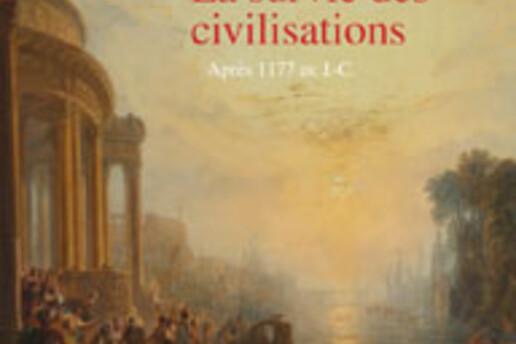L'Etat doit se réformer ! A force d'être martelée à longueur de temps par des essayistes plus ou moins inspirés, cette injonction a aujourd'hui quasiment valeur de dogme. On en oublierait presque qu'en vingt-cinq ans, l'Etat, dans notre pays, est entré dans une nouvelle ère. C'en est bel et bien fini du sacro-saint Etat dirigiste. L'Etat, en matière économique, s'est considérablement désengagé. On aurait plutôt affaire aujourd'hui à ce qu'il est convenu d'appeler un Etat régulateur : un Etat, autrement dit, qui encadre, qui aiguille plus qu'il ne dirige.
Jusqu'à la fin des années 70, l'Etat français était aux commandes de l'économie. Il ne disposait pas seulement, comme tous les gouvernements des pays développés, des outils keynésiens de régulation macroéconomique. Avec les nationalisations, la planification et la Sécurité sociale, il s'était doté d'outils lui permettant d'intervenir jusque dans les champs microéconomique et microsocial. J'ai qualifié cet Etat, dans divers écrits, d'Etat national rationnel équitable. Cet Etat national rationnel équitable, c'est l'Etat tel qu'il s'est construit après-guerre, favorisé tant par les gouvernements de droite que de gauche. Il n'y a en effet jamais eu, jusqu'au milieu des années 80, de grand bouleversement en matière de politique économique. La classe dirigeante, par-delà les alternances, a toujours privilégié la même équation, associant compromis social inflationniste, économie de financements administrés et «colbertisme» high-tech.
J'emploie le terme de compromis social inflationniste, car à l'époque, Etat, syndicats et patrons étaient d'accord pour considérer comme secondaire la question de la lutte contre l'inflation. L'accroissement rapide des prix n'était pas considéré comme un problème. Dans ce modèle, l'inflation était considérée du point de vue des avantages qu'elle procurait : elle entretenait la croissance, l'autofinancement, et permettait des transferts indolores.
Bien entendu, dans un contexte d'ouverture de l'économie française à la concurrence mondiale, cette politique inflationniste avait également ses inconvénients : des déséquilibres périodiques de compétitivité se soldaient par la dévaluation. Pour retrouver des coûts comparables à ceux de ses voisins et compétiteurs, pour éliminer les effets de la course prix-salaires, pour ajuster les gains de pouvoir d'achat aux gains réels de productivité, les autorités procédaient périodiquement à des dévaluations. C'était la sanction de ce compromis social inflationniste, mais comme telle, elle était acceptée par les partenaires sociaux. Un syndicalisme de lutte des classes et un patronat resté essentiellement patrimonial ne pouvant cogérer, le partage des responsabilités se faisait ailleurs, à l'ombre de l'Etat : aux entreprises, la gestion économique dans un univers de marché ; aux syndicats, celle du social (gestion de la protection sociale par les partenaires sociaux) ; à l'Etat, l'extension des avantages sociaux par la loi, la régulation d'ensemble et la substitution ponctuelle à l'initiative privée défaillante (les grands projets industriels, l'économie de financements administrés).
Cette division des tâches, associée à la forte croissance des années 1954-1974, a permis de financer les transferts de revenus et l'équipement du pays ; l'inflation récurrente a permis l'étalement de la mutation agricole et commerciale ; enfin, le système financier contrôlé par l'Etat a permis d'orienter les ressources du pays vers les secteurs désignés comme cruciaux : le logement, l'agriculture, l'équipement du territoire.