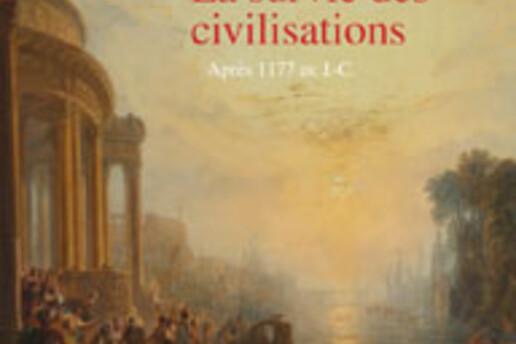On a comparé l'État à un monstre marin (le fameux Léviathan de Thomas Hobbes), à un cyclope 1, à une pieuvre, un ogre, une usine à gaz, une citadelle, une vache à lait, etc.
Toutes ces images désignent l'Etat comme un organisme géant - monstrueux ou bienfaisant - qui ne cesse d'étendre ses ramifications sur la société. Et de fait, le volume de l'Etat n'a cessé de s'étendre au fil du temps. Au début du xxe siècle, le poids des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) représentait à peine 10 % du PIB. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il était monté à environ 30 %. Aujourd'hui, il représente 46 %, soit près de la moitié du revenu national. Limité au départ aux fonctions régaliennes de police, armée et justice (« l'Etat gendarme »), l'Etat a étendu son champ d'intervention à l'éducation (« Etat éducateur »), au social (« Etat providence »), à l'économie (« Etat producteur » et « régulateur ») (voir l'article de Jean Vavasseur-Desperriers, p. 28). Enseignants, policiers, postiers, militaires, infirmières, contrôleurs, comptables, secrétaires... des millions de fonctionnaires et d'agents de l'Etat (un salarié sur quatre) travaillent pour cette énorme machine tentaculaire composée d'organes multiples.
En prenant de l'ampleur, la gestion de cet édifice étatique est devenue de plus en plus lourde, complexe et opaque, et la question de la réforme de l'Etat est devenue un thème récurrent. Ces dernières années, pas moins de trente rapports, bilans et essais ont été publiés sur le sujet 2. Une partie a été commandée directement par le gouvernement ou le Commissariat au plan. La plupart sont allés rejoindre le rayon, déjà lourdement chargé, des projets de réformes sans suite.
Devant le nombre de projets enterrés et de réformes avortées (école, impôts, justice, santé, retraites...), les propos amers et désabusés s'accumulent sur l'impuissance publique, les résistances corporatives, le manque de volontarisme politique... Or, cette lancinante complainte sur « l'impossible réforme de l'Etat » correspond-elle vraiment à la réalité ? Rien n'est moins sûr.
Une « révolution libérale masquée » ?
En un quart de siècle, il y a eu des changements profonds de la place de l'Etat dans la société française. Des mutations en partie masquées, mais qui touchent pourtant au coeur de l'action publique.
- La première grande mutation concerne le retrait de l'Etat de la sphère économique. Durant l'ère gaulliste, l'Etat français a connu un « âge d'or » dans le pilotage de l'économie 3. Il assumait à la fois des fonctions d'autorité monétaire et financière, de régulateur économique (politiques keynésiennes), d'entrepreneur industriel (le « colbertisme » à la française, qui a donné naissance aux grands fleurons de l'industrie française : le Concorde, le TGV, le parc électronucléaire). Or, depuis la fin des années 80, cette époque est révolue. L'Etat a perdu l'essentiel de ses prérogatives en matière économique. La mondialisation du commerce et des marchés boursiers a privé l'Etat des leviers traditionnels du keynésianisme, la création de l'euro a mis fin à la souveraineté monétaire. Les privatisations quasi totales du secteur bancaire et partielles des grandes entreprises industrielles ont mis fin à l'Etat entrepreneur...
Cela ne signifie pas que l'Etat n'assure plus aucun rôle économique. Le montant de ses dépenses suffit à en faire l'acteur-clé du circuit économique, mais il agit dans ce cas au titre de « pompe aspirante » de l'économie plutôt que comme pilote.
- Une seconde grande mutation touche aux mécanismes de la décision publique. La France est un pays marqué par une centralisation administrative. Si on en croit Tocqueville, la tradition centralisatrice précède la Révolution et date de l'Ancien Régime. C'est de Paris et des bureaux des ministères qu'ont toujours été prises ou validées les décisions concernant les régions. Le réseau ferroviaire français, structuré tel une toile d'araignée autour du coeur parisien, est à l'image du système administratif. Or, cette logique est bousculée depuis vingt ans par deux évolutions majeures : la décentralisation, d'une part, et la construction européenne de l'autre.
Avec la décentralisation - initiée en 1982 par les lois Deferre -, de nombreuses compétences ont été transférées vers les collectivités locales (villes, départements, régions), multipliant ainsi les instances et niveaux de décision. Désormais, le sort des territoires n'est plus confié à un préfet tout-puissant, mais se joue dans un jeu complexe entre communes, institutions intercommunales, administrations locales et autres acteurs de la société civile.
Avec la construction européenne, l'Etat s'est également dépossédé de certaines de ses marges de manoeuvre (au grand dam des « souverainistes » qui y voient la perte de maîtrise d'un peuple sur son destin). De la politique agricole au droit de la concurrence, en passant par le montant des déficits publics ou le droit de la chasse, les politiques nationales sont désormais fortement encadrées par de nombreuses directives européennes.
L'Etat français a donc été soumis à une double évolution : perte de pouvoir par le haut (Europe) et par le bas (décentralisation) ; cette évolution semble se conformer au principe énoncé par Daniel Bell, qui veut que, désormais, l'Etat soit « trop grand pour gérer les petites choses et trop petit pour les grandes choses ».
Les théories actuelles de la gouvernance visent à prendre en compte la multiplicité des centres de pouvoir dans les Etats modernes, sous l'effet notamment de la décentralisation, de la mise en place de l'Europe. A un centre de pouvoir unique et concentré se substituent des instances multiples, impliquées dans une action publique. Dans ce dispositif complexe, personne ne détient le pouvoir, mais tout le monde en détient une parcelle. D'où une opacité des mécanismes de décision et un brouillage des frontières et des responsabilités 4.
L'Europe et la décentralisation ont conduit à une multiplication des instances de décision administrative. On est passé d'un modèle « pyramidal » à un modèle « polycentrique ». A cela s'ajoute une nouvelle façon de concevoir l'action publique. Au lieu de penser l'action de l'Etat comme l'émanation d'une décision centrale, impulsée par un ministère et appliquée par un corps de fonctionnaires, on envisage de plus en plus l'action publique sous l'angle de la subsidiarité, du partenariat, de la régulation. La politique de la ville a été conçue sur ce mode : aux collectivités locales et associations d'impulser des projets. L'Etat n'est là que pour aider, soutenir, assister, bref pour jouer un rôle « d'Etat animateur ».