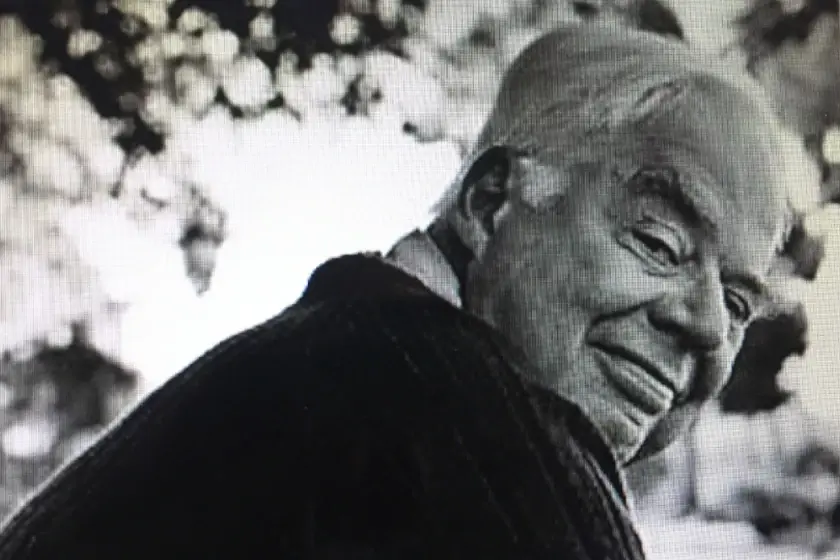
Rarement en philosophie le mot aura autant fait de mal à la chose. Le pragmatique, selon l’usage courant, c’est le pratique, ce qui sert à quelque chose, ce qui est utile. Cette image simpliste aura longtemps pesé sur ce courant philosophique. Certes les déclarations de Bertrand Russell auront desservi le mouvement (« une philosophie de commerçant ») en le réduisant, avec d’autres, à un américanisme supposé, une doctrine de businessman confondant vérité et intérêt. Certes, les désaccords entre les pères du pragmatisme eux-mêmes, Charles Peirce et William James principalement, ajouteront à la confusion. Le premier d’ailleurs, ne se reconnaissant pas dans l’orientation psychologique du second, rebaptisa sa doctrine « pragmaticisme », terme « suffisamment laid pour échapper aux kidnappeurs ». Qui plus est, certains de ses représentants les plus éminents ont avancé qu’il existait autant de pragmatismes que de pragmatiques et que, à bien y regarder, des éléments pragmatistes se retrouveraient dans des pensées aussi diverses que celles d’Aristote, Emmanuel Kant, Martin Heidegger ou Michel Foucault… Si tout est pragmatique rien n’est pragmatique.
A minima, le pragmatisme peut alors être défini comme une méthode pour rendre les idées claires et une théorie de la vérité. Descartes, voilà l’ennemi, lui qui pensait, après avoir douté de tout, avoir trouvé le fondement de la connaissance dans la conscience. Pour Peirce, ce doute universel est un leurre, une fiction théorique à laquelle il oppose le doute réel : « Ne prétendons pas douter en philosophie de ce dont nous ne doutons pas dans nos cœurs. » La conscience de soi n’est pas le point de départ mais un point d’arrivée, celui d’interactions sociales et publiques, de « notions communes » (langage, croyances) qui déterminent notre conscience.














