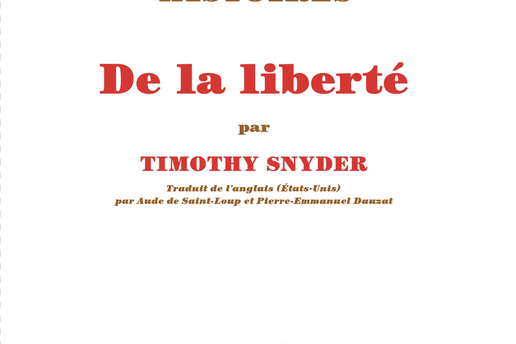Des ancêtres gaulois au baptême de Clovis, de la prise de la Bastille à la Commune de Paris, la mémoire collective française est pleine de héros et d’événements triés sur le volet, constitutifs d’un « roman national » écrit en bonne partie au XIXe siècle. Ce « catéchisme de la République », comme l’appelle l’historien Pierre Nora, a d’abord été transmis de génération en génération par l’école, notamment par des manuels scolaires comme le Petit Lavisse (1), avant d’être soumis au regard critique des historiens. Des zones d’ombre telles que la Traite atlantique, les guerres de Vendée pendant la Révolution, le régime de Vichy lors de la Seconde Guerre mondiale et les « événements » d’Algérie dans les années 1960 ont longtemps fait partie des trous de la mémoire française. Et pour cause : leur oubli a pour fonction de construire une mémoire commune censée faciliter le vivre ensemble. « Qu’on le veuille ou non, la nation a été bâtie sur l’occultation ou l’oubli volontaire. Mais faut-il accepter des fautes historiques au nom du roman national ? », interrogeaient, en 2007, le sociologue Éric Keslassy et le philosophe Alexis Rosenbaum (2). Au même moment, la notion d’identité nationale faisait l’objet d’un débat houleux, et bien des historiens se levaient pour contester toute tentative de lui donner un contenu précis : comme l’écrira P. Nora en 2010, l’identité de la France n’a cessé de changer au cours de l’histoire. Ces « romans historiques », qu’ils soient nationaux, régionaux ou communautaires, sont le produit d’une mémoire qui trie et sélectionne les événements du passé, et leur donne une valeur que l’on juge digne ou utile de transmettre (3).
Selon É. Keslassy et A. Rosenbaum, la mémoire, qui désigne d’abord les souvenirs propres à chacun, se transforme en activité sociale dès le moment où elle fait l’objet d’une communication. Les expériences mémorables de certains groupes – qu’elles soient tragiques comme le drame de la déportation pour les Juifs et de l’esclavage pour les Noirs, ou libératrices comme l’aventure hippie des années 1970 – sont racontées, commentées, dramatisées par les individus qui les ont vécues et se transforment en « mémoire collective partagée », transmise de génération en génération à travers des livres, des films, des commémorations et des conférences. Devenues de pures interprétations d’événements historiques, ces mémoires collectives entament une existence qui leur est propre et qui, bien souvent, s’éloigne des buts de l’histoire scientifique. « C’est à partir du moment où la transmission culturelle directe et vivante se dissout que le passé devient à la fois un problème psychologique et une ressource politique », observent É. Keslassy et A. Rosenbaum.
Les travaux de l’anthropologue américain Bernard Wong sur la communauté chinoise new-yorkaise ont mis en évidence, dans les années 1970, les différents usages qui peuvent être faits de cette mémoire collective. Pour une certaine élite chinoise traditionnelle (Kiu Ling), composée de membres plutôt âgés, elle servait à maintenir d’anciennes coutumes et un mode d’organisation communautaire, à l’écart de la société civile. Mais pour de plus jeunes activistes (Chuen Ka), plus américanisés, elle servait de base pour se constituer en groupe d’intérêt. En invoquant notamment le sort tragique des premiers immigrants chinois aux États-Unis, ces jeunes gens justifiaient des revendications d’ordre politique et économique. Si la mémoire est attirante pour certains groupes sociaux, c'est qu’elle tire parti d’un passé confirmant leur singularité, leur ancienneté et leur cohésion. L’appel à l’identité ethnique ou culturelle offre des bénéfices psychologiques et socioéconomiques supérieurs à ceux que promet l’appartenance à des groupes professionnels, sportifs, associatifs, etc. Dans la France d’aujourd’hui, de tels phénomènes existent, notamment parmi certaines minorités postcoloniales, mais c’est aussi le cas dans les régions, voire à l’échelle du pays tout entier (4).