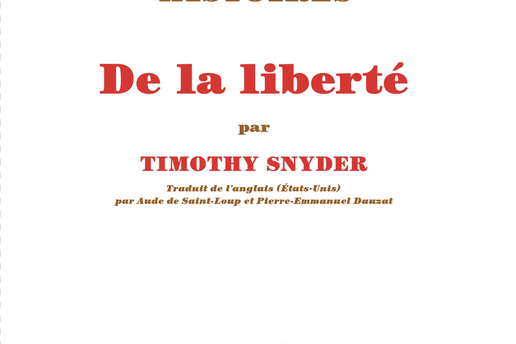Ce livre, Les souvenirs viennent à ma rencontre, se présente comme un livre de « souvenirs » et non de mémoires. Quelle est la différence ?
Les mémoires se présentent généralement comme une biographie ou l’auteur suit un ordre chronologique ; elles supposent aussi un travail de documentation sur sa propre histoire pour recomposer sa trajectoire de vie, même si cette reconstitution est en partie factice.
Ce livre, je l’ai écrit dans l’élan où me sont venus les souvenirs. Ils ne sont pas exposés de façon chronologique. Ces souvenirs sont « venus à ma rencontre » comme l’annonce le titre. J’ai redonné ensuite un certain ordre pour la publication, mais j’ai voulu garder cet élan initial et focaliser mon attention sur les personnes, les rencontres, les événements qui ont été les plus marquants pour moi. Et qui m’ont forgé.
L’ordre thématique prime en effet sur l’ordre chronologique. Ainsi, la confrontation avec la mort, qu’on pourrait attendre dans un chapitre final, est présente dès le début : avec l’histoire d’un petit garçon qui, très tôt, a été confronté à sa mort imminente.
Effectivement, j’ai croisé la mort très tôt. Dès le stade fœtal. Ma mère souffrait d’une maladie cardiaque et on craignait que son cœur ne puisse résister à un accouchement. Quand elle s’est retrouvée enceinte, elle a pris des médicaments pour m’avorter. Mais cela n’a pas marché : je suis donc passé à côté de la mort une première fois. Ma naissance fut une seconde confrontation à la mort, car je suis né étranglé par le cordon ombilical. Il a fallu plusieurs minutes pour me ranimer. Ce ne fut qu’in extremis, comme mon père le raconta bien plus tard, que le médecin m’a ramené à la vie. Cette présence de la mort ne m’a laissé aucune trace de souvenirs consciente bien sûr ; par contre, la mort de ma mère quand j’avais 10 ans fut un cataclysme fondateur : une perte de l’absolu qui m’a forcé à vivre sans absolu. Par la suite, j’ai encore frôlé la mort lorsque j’avais 20-25 ans durant la Résistance. Voilà pourquoi cette histoire commence par la mort. Elle m’a hanté très tôt. Très tôt, j’ai compris que vie et mort étaient indissolubles.
La mort est d’ailleurs le thème de l’un de vos premiers livres L’Homme et la Mort (1951). L’une de ses thèses est que dans toutes les civilisations, les humains ont forgé un imaginaire de l’au-delà. Ils nient la mort à travers les mythes de l’immortalité de l’âme.
Oui, l’imaginaire m’avait déjà aidé à survivre après la mort de ma mère. Je m’étais plongé dans les romans et le cinéma qui m’aidaient à fuir un réel insupportable. Puis j’ai découvert, à l’occasion de la rédaction de L’Homme et la Mort, le rôle fondamental de l’imaginaire dans l’histoire humaine. J’ai alors pris mes distances avec la vision marxiste qui fait des idées une « superstructure » s’élevant au-dessus d’une infrastructure matérielle. L’imaginaire est consubstantiel à l’existence humaine. De plusieurs façons : tout d’abord, l’imaginaire enchante et poétise la vie ; il est ensuite intimement lié à la vie par le biais de la rêverie, les anticipations, les espérances, les projets, les utopies ; enfin et paradoxalement, l’imagination est aussi une voie d’accès à la connaissance. Le roman et le cinéma sont des fictions, mais certaines fictions ont ce pouvoir de nous faire découvrir des réalités que l’on a du mal à percevoir au contact direct du réel.