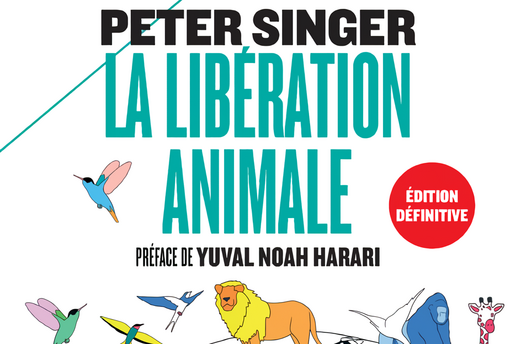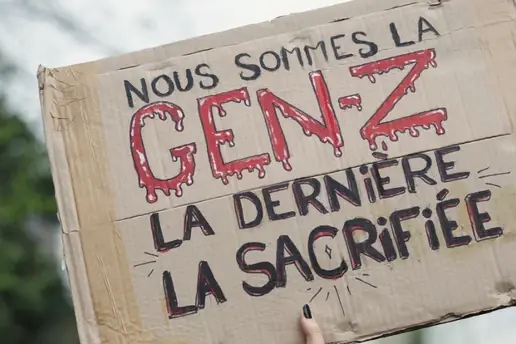Polytechnicien, ingénieur des mines et versé dans la science des systèmes, Jean-Pierre Dupuy n’en est pas moins un philosophe dont les maîtres à penser sont de grands inspirés. Tout au long de son œuvre en apparence dispersée, il n’a cessé d’examiner la même question : comment les hommes peuvent-ils s’accorder dans un monde débarrassé de toute transcendance ? Des feux de la pensée d’Ivan Illich, il a retenu la critique des absurdes gâchis de la modernité industrielle et l’éloge de l’amitié. De René Girard, il a hérité le principe du désir mimétique et l’adieu au sacrifice. D’Adam Smith et John Rawls, la menace que fait peser sur les sociétés marchandes le démon de l’envie.
Homme de convictions enthousiastes, J.‑P. Dupuy n’en est pas moins doté d’un solide esprit de géométrie, qui le porte à l’examen raisonné des problèmes qui l’occupent et de leurs impasses logiques. Le principe responsabilité du philosophe Hans Jonas tirait, il y a plus de trente ans, la leçon d’une menace inédite : la possibilité désormais avérée des sociétés technologiquement avancées de s’autodétruire. Aujourd’hui, au-delà du mal que les hommes peuvent se causer entre eux, nous vivons sous le signe d’une grande catastrophe environnementale. Quelles leçons devons-nous tirer de celles, plus limitées, qui périodiquement émaillent l’avancement des sociétés industrialisées ? Pouvons-nous les passer par pertes et profits ?
Depuis de nombreuses années, vous réfléchissez aux dangers qui pèsent sur l’environnement. Face à l’éventualité de la catastrophe, vous jugez que la prévention tout comme le principe de précaution sont insuffisants et vous estimez non pertinent le recours incessant fait au terme de « risques ». Pourquoi ?
Le péché originel du principe de précaution est d’avoir cru que ce qui justifiait l’obligation d’inventer une nouvelle maxime de prudence était une condition épistémique – ce que l’on sait ou ne sait pas au sujet du « risque » en question – et non pas l’énormité des enjeux. C’est parce que nous sommes devenus capables de produire et de détruire, avec une puissance inouïe qui dépasse notre capacité d’imagination et de pensée, que nous devons concevoir de nouvelles formes de prudence et de prévention. Ce n’est pas le manque de savoir qui est la situation inédite, mais l’incapacité de penser et d’imaginer les conséquences et les implications de nos actions. Lorsque le « risque » se réalise en catastrophe, il a toutes les apparences de la fatalité. Un risque, cela se « prend ». Les catastrophes, elles, nous tombent sur la tête comme si elles venaient du ciel – et pourtant, nous en sommes seuls responsables.
À force de crier à la catastrophe, n’émousse-t-on pas la sensibilité aux dangers encourus ? Que peut vraiment le philosophe face aux menaces ?
Même si c’est un cas particulier, c’est la discussion philosophique de la dissuasion nucléaire qui m’a ouvert les yeux sur le problème que vous posez. Plusieurs dizaines de fois au cours de la guerre froide, il s’en est fallu de très peu que l’humanité disparaisse en vapeurs radioactives. Chaque fois ou presque, un accident, c’est-à-dire quelque chose que personne n’avait voulu, en était responsable. Échec de la dissuasion ? C’est tout le contraire : ce sont précisément ces incursions dans le voisinage du trou noir qui ont donné à la menace d’anéantissement mutuel son pouvoir dissuasif. C’est ce flirt répété avec l’apocalypse qui, en un sens, nous a sauvés. Il faut des accidents pour précipiter le destin catastrophique mais, contrairement au destin, un accident peut ne pas se produire. D’où cette partie de poker contre l’aléa, qui consiste à jouer constamment avec le feu : pas trop près, de peur que nous y périssions carbonisés ; mais pas trop loin non plus, de peur d’oublier le danger. C’est dans la juste distance entre l’insouciance et le catastrophisme que se situe la rationalité.