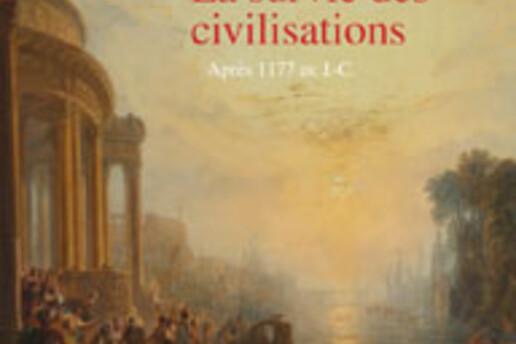L’Onu estime que plus d’un tiers de la population urbaine du monde, soit plus d’un milliard d’individus, vit aujourd’hui dans un habitat informel et/ou précaire (1). Selon d’autres sources, c’est la moitié des citadins du monde, soit un humain sur quatre, qui vit dans des conditions comparables – ou pires – à celles que décrivait l’écrivain Charles Dickens au milieu du xixe siècle dans les taudis de Londres (2)…
Il existe aujourd’hui entre 200 000 et 250 000 bidonvilles sur la planète, comptant de quelques centaines à plus d’un million d’habitants. Les cinq plus grandes métropoles d’Asie du Sud – Karachi, Mumbay (Bombay), Delhi, Calcutta et Dhaka – regroupent à elles seules 15 000 bidonvilles distincts, avec une population totale de plus de 20 millions de personnes. Dharavi, par exemple, le bidonville des travailleurs du cuir, sans doute le plus grand d’Asie, regroupe un million de personnes sur 300 hectares et forme une ville à part entière au sein de l’agglomération urbaine de Mumbay, une véritable société parallèle que Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky a décrite dans le détail (3). Sur la côte ouest-africaine, un couloir de bidonvilles de 70 millions de personnes s’étire d’Abidjan à Ibadan, et constitue une des plus grosses empreintes continues de misère sur notre planète. Au Caire, les zones dites d’urbanisation spontanée couvrent 13 000 hectares et abritent environ 6 millions d’habitants. Dans certains pays, c’est quasiment la totalité de la population urbaine qui vit en bidonville, comme en Ethiopie (99,4 %), au Tchad (99,4 %), en Afghanistan (98,5 %) (voir le tableau p. 27)…
Les bidonvilles ont assurément un brillant avenir devant eux. La moitié au moins de l’explosion démographique urbaine annoncée du tiers-monde sera à mettre au compte des quartiers sauvages. Les projections moyennes donnent deux milliards d’habitants de bidonvilles dans la décennie 2020. S’agit-il d’un phénomène général, et presque irréversible, d’involution urbaine ? Serions-nous arrivés à l’âge du « bidonville global » ? En tout cas, et si tant est qu’il existe un individu représentatif de l’humanité du xxie siècle, il y a de grandes chances pour qu’il s’agisse d’un individu jeune, résidant dans un bidonville des faubourgs d’une ville du Sud. Cette humanité « excédentaire », marginalisée, presque invisible, est pourtant numériquement supérieure à la population des pays dits « développés ». Largement occultée par les médias, cette réalité du monde reste finalement assez peu étudiée par les chercheurs. Le contraste est frappant avec l’avalanche de travaux consacrés aux quartiers « sensibles » des banlieues des pays riches, en particulier l’Europe et les Etats-Unis.
Un cocktail létal
La prédominance des bidonvilles dans le monde constitue néanmoins le sujet principal de « The Challenge of the Slums » (« Le défi des bidonvilles »), le rapport publié fin 2003 par le Programme des Nations unies pour les établissements humains (UN-Habitat). Il s’agit du premier audit mondial de la pauvreté urbaine, qui regroupe les travaux de plus de cent chercheurs. L’étude utilise une banque de données comparatives de 237 villes, intègre les nouvelles données mondiales sur le logement et s’appuie sur des études de cas de la pauvreté, des conditions de vie dans les bidonvilles et des politiques du logement dans 34 métropoles. Ce document constitue un avertissement sans précédent sur la catastrophe mondiale qu’est la misère urbaine.Les problèmes sanitaires des bidonvilles sont immenses. A l’absence d’adduction d’eau ou à la déficience de son approvisionnement et de sa qualité, s’ajoute l’insuffisance, voire l’inexistence, de système d’égout et d’évacuation des déchets. Un terrain propice, s’il en est, à la propagation d’infections et maladies de toutes sortes. 2,4 milliards d’habitants dans le monde n’ont ainsi pas accès à un système d’assainissement approprié. L’agglomération de Kinshasa par exemple, avec une population de près de 10 millions d’habitants, n’a pas le moindre système de tout-à-l’égout. Quant aux habitants des quartiers pauvres de Mumbay, ils ne disposent que d’une seule cuvette de WC pour 500 habitants.
Les bidonvilles sont souvent situés dans des zones impropres à l’habitation, à la fois insalubres et dangereuses : bas-côtés des autoroutes ou des voies ferrées, marécages et zones inondables, flancs de collines instables, décharges et terrils d’ordures, abords d’usines. Ils sont menacés par les pollutions diverses : envahissement par les déchets de plastique, gaz d’échappement des véhicules, pollutions industrielles. Toutes ces conditions constituent évidemment de graves menaces pour la santé des habitants, avec une forte mortalité infantile et une baisse de l’espérance de vie. D’autant que les services médicaux et éducatifs y sont déficients ou inexistants.
Une typologie de l’habitat dégradé
Dans Le Pire des mondes possibles, le chercheur américain indépendant Mike Davis propose une sorte de tour du monde des bidonvilles et livre au final un tableau quelque peu hallucinant de la déréliction urbaine contemporaine (4). Selon lui, l’augmentation exponentielle des bidonvilles à partir des années 1980 est en partie due aux instances internationales, au premier rang desquelles le FMI et la Banque mondiale, qui ont utilisé le levier de la dette pour « restructurer » les économies de la plupart des pays du tiers-monde et pour couper dans les dépenses publiques. Des populations précarisées, et/ou déracinées du fait de l’exode rural, n’ont eu alors d’autre choix que de venir gonfler les zones d’habitat informel. D’autres mécanismes entrent en jeu. La spéculation privée illégale sur les terrains périphériques et l’exploitation des plus déshérités génèrent d’importants profits. Certains bidonvilles sont ainsi de vastes exploitations locatives intensives possédées par des membres de la classe moyenne supérieure et par les politiciens locaux.En fait, le terme anglais fourre-tout de « slum » utilisé par les instances internationales (5), de même que sa traduction française par les termes de « bidonville » ou de « taudis », ne permettent pas de décrire les multiples nuances de l’habitat précaire et spontané. Le bidonville n’est que l’arbre qui cache la forêt urbaine du « mal-développement ». Sans vouloir édulcorer la réalité, il est donc prudent de ne pas assimiler tous les quartiers non réglementaires à de prétendus bidonvilles, une appellation par ailleurs très stigmatisante.
• Ainsi, au sens étroit du terme, « bidonville » désigne les quartiers d’habitat les plus rudimentaires (baraques instables, huttes, tentes) construits avec des matériaux de récupération (bidons, plastiques, tôles, bâches, cartons). Insalubres, non viabilisés et non équipés, densément peuplés, ils forment des ensembles anarchiques, sans trame urbaine, aux ruelles tortueuses en terre.
• Ces bidonvilles stricto sensu doivent donc être distingués des nombreuses formes d’habitations non réglementaires mais construites en dur (briques, parpaings, matériaux traditionnels). Bien que souvent mal viabilisées et disposant d’un équipement défectueux, elles sont un peu plus pérennes. Ces formes d’habitat (qu’il s’agisse d’un bidonville consolidé ou de maisons directement construites en dur) sont en fait les plus fréquentes. De nombreuses favelas brésiliennes, construites en briques creuses, sont bien établies : ces habitations à géométrie évolutive, faites de petites pièces emboîtées, comptent parfois plusieurs étages et disposent d’un confort relatif (branchement électrique sauvage, adduction d’eau, télévision satellite, etc.).
• « Bidonville » s’oppose aussi à « taudis », qui désigne spécifiquement des bâtiments anciens des quartiers centraux, abandonnés par leurs anciens occupants et devenus insalubres. Ils sont alors loués ou squattés par des populations marginalisées.
• Enfin, l’« habitat individuel de fortune » concerne la cohorte d’individus vivant dans la rue, dans le dénuement matériel et sans système d’entraide communautaire. Par exemple, les pavement dwellers des grandes métropoles indiennes, habitants des trottoirs, ne peuvent se payer le luxe d’une construction irrégulière ; ils disposent d’une hutte adossée aux murs des bâtiments urbains ou aux barrières, de quelques cartons ou d’une simple bâche. Certains îlots dégradés de Old Delhi ont accueilli jusqu’à 200 000 sans-abri vivant ainsi dans les ruelles.
Bien que la distinction urbain/périurbain soit souvent arbitraire, on considère globalement qu’à l’échelle du monde, la population périurbaine dépasse aujourd’hui la population urbaine proprement dite (en zones centrales). Les grandes villes des pays en dévelopement sont marquées par des extensions d’une surface considérable. L’agglomération de Mexico par exemple couvre une surface bâtie de plus de 8 000 km2, celle de Shanghai de plus de 6 500 km2. Bagdad ou Buenos Aires développent un rayon urbain de plus de 40 kilomètres à partir du centre-ville. Casablanca a multiplié sa surface bâtie par 150 en quatre générations, etc. Or l’expansion spatiale des villes du Sud s’est souvent faite sans plan d’urbanisme ni aménagement foncier. D’où des espaces suburbains et périurbains qui sont hétérogènes, faiblement articulés entre eux et mal intégrés à l’agglomération. Dans certains cas, c’est l’ensemble de l’agglomération qui prend l’allure d’une immense périphérie plane et monotone avec des constructions basses, une prolifération de quartiers informels, un tissu urbain dégradé dans un environnement pollué. Le centre-ville, quand il existe, apparaît alors comme le témoignage résiduel d’une urbanité révolue. De la ville à proprement parler, on passe à une sorte de magma urbain étalé et désagrégé, souvent chaotique.
Au sein d’un archipel urbain bâti en forme de kaléidoscope émergent quelques isolats de richesses : quartiers résidentiels huppés protégés comme des forteresses (townhouses d’Afrique australe, barrios cerrados argentins, condomínios fechados brésiliens…), centres des affaires et du tertiaire, centres commerciaux, quartiers touristiques. Tandis que les innombrables espaces d’urbanisation informelle (périphéries pauvres, marges et enclaves) sont exclus de cette nouvelle géographie.
Néocitadins ou anciens ruraux ayant transité par les taudis du centre, migrants urbains, classes moyennes du centre-ville frappées d’appauvrissement…, tous sont relégués vers ces quartiers périphériques souvent non réglementaires. En l’absence de production de logement social ou d’accès à des systèmes de financement, les migrants les plus pauvres ont souvent recours, dans un premier temps, aux occupations collectives de terrain, avec autoconstruction rapide d’installations précaires : invasiones ou invasões en Amérique latine, squats ou squatter settlements en Asie, campements en Afrique.
Une vie dynamique malgré tout
Le mouvement général d’extension de l’habitat spontané en proche couronne ou en périphérie n’exclut d’ailleurs pas que les espaces interstitiels et incommodes des zones centrales traditionnelles soient investis par des îlots d’habitat précaire et irrégulier. C’est le cas par exemple des favelas accrochées aux flancs pentus des mornes du centre de Rio. C’est le cas aussi au Caire, avec les nombreux cabanons sur le toit des immeubles centraux, ou même dans les cimetières ! Ainsi dans la « Cité des morts », ce sont les vivants qui s’installent dans les mausolées ou dans des masures construites entre les tombes…
Pour M. Davis, les « hyperbidonvilles » représentent des incubateurs sans précédent dans l’histoire, de véritables bombes à retardement. Il est pourtant difficile de prévoir la façon dont va évoluer cet immense prolétariat informel. Le succès rapide du christianisme pentecôtiste ou de l’islam populiste montre en tout cas que ces chaudrons de précarité offrent un terreau propice au fondamentalisme religieux. Les bidonvilles s’inscrivent dans un contexte de relégation sociale, de démission de l’Etat et de crise des infrastructures. Ils sont généralement perçus, souvent à juste titre, comme une pathologie urbaine, un désastre social, sanitaire et écologique. Ces lieux ne se résument pourtant pas à des zones de misère et de chaos social. Ce sont aussi des établissements humains dynamiques et qui participent largement à l’infrastructure économique. L’informalité et le pragmatisme inventif de la débrouille ne concernent pas seulement le logement mais les activités économiques et même culturelles qui se déploient dans ces zones. Des microéconomies de quartier permettent l’amélioration partielle des conditions de vie. Le secteur informel y fonctionne comme intégrateur urbain, comme une indispensable soupape de sécurité face aux gigantesques lacunes de l’emploi, et souvent aussi comme tremplin à l’expansion des activités formelles. Malgré l’impression de confusion et d’anarchie, de nombreux quartiers défavorisés connaissent des formes d’organisations originales à l’échelle locale (autogestion, formes d’administration et de démocratie participative). L’inscription sociale dans l’espace local est souvent forte et renforce l’identité collective qui s’y développe. Au Brésil, les habitants des quartiers informels parlent par exemple de la comunidade pour désigner leur groupe sociospatial d’appartenance.
Il y a eu par le passé de nombreuses politiques d’éradication des bidonvilles, de déménagement forcé et nettoyage de quartiers illégaux, des expulsions pour la réalisation de grands chantiers ou pour la rénovation du centre historique. La tendance générale, depuis en gros les années 1970, est désormais plutôt à la légalisation puis à l’amélioration des zones d’habitat informel et spontané, avec assainissement, viabilisation et consolidation progressive. En effet, il est souvent moins problématique et moins coûteux pour les pouvoirs publics de légitimer a posteriori des solutions de logements précaires en proposant une « urbanisation » sur place. Le passage du bidonville au quartier modeste est possible. Par exemple, dans la banlieue sud de Lima, l’autogestion des habitants, doublée d’une aide initiale des autorités, a permis à l’immense bidonville Villa El Salvador de surmonter la précarité et d’accéder au statut de municipalité.
Dans ce processus, la reconnaissance de l’occupation foncière constitue une condition centrale. Mais la régularisation et l’octroi de droits de propriété ne sont pourtant pas toujours exempts d’effets pervers, avec l’apparition possible de nouvelles divisions et exclusions.
Après avoir été souvent diabolisés, considérés comme une plaie urbaine à supprimer, les bidonvilles sont parfois maintenant présentés comme une leçon d’architecture et d’organisation communautaire, comme une démonstration de la capacité de débrouille des plus pauvres… Le paradigme actuel d’amélioration des bidonvilles (défendu par les instances internationales et certaines ONG) peut ainsi apparaître aussi comme une façon d’entériner son existence…
NOTES