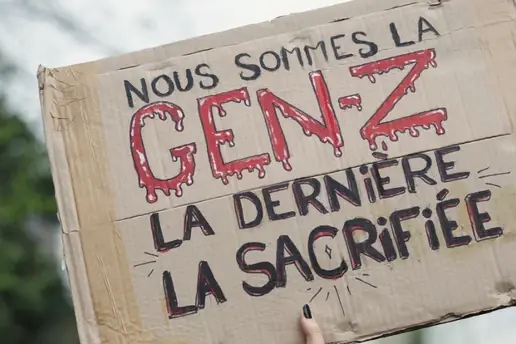Dans développement durable, il y a « développement », et « durable ». Depuis la fin de la guerre froide, le mot développement est devenu presque déplacé : on lui reproche d’être historiquement connoté (un produit de la guerre froide), et il est souvent caricaturé comme synonyme de croissance économique. De ce fait, toutes les définitions du développement durable, à commencer par celle du rapport Brundtland (voir le texte principal p. 8), ne se donnent pas la peine de revenir sur le mot développement, s’attachant d’abord à la notion de durable. Il faut préserver notre capital pour les générations futures. Une formule attribuée à Antoine de Saint-Exupéry résume la question : « La Terre n’est pas ce que nous avons hérité de nos ancêtres mais ce que nous avons emprunté à nos enfants. »
Durabilité forte et durabilité faible
En réalité, la durabilité peut s’analyser de deux façons. Pour les partisans de la durabilité dite forte, le capital naturel de la Terre doit absolument être maintenu en état. Ceux qui défendent la durabilité dite faible estiment au contraire qu’il suffit que la somme du capital naturel et du capital construit par l’homme soit maintenue constante : peu importe que le capital naturel disparaisse si le capital construit peut lui être substitué.
Dans le premier cas, la durabilité forte, l’environnement prime : l’être humain n’est qu’une espèce parmi d’autres sur la Terre. Il faut donc limiter ses activités, l’empêcher de nuire. La conservation des espaces naturels, voire leur sanctuarisation doivent être privilégiées.
Les tenants de la durabilité faible manifestent, eux, une grande confiance dans les vertus du progrès technique. Ils observent que si les premières phases du décollage économique d’un pays sont très prédatrices pour l’environnement, les pays les plus avancés savent au contraire mettre en place des technologies propres et réduire l’impact écologique de leurs activités. Pour eux, c’est l’humanité qui prime : à quoi bon protéger la nature, pensent-ils, si elle n’est pas mise au service de la société ? Le fait que certaines nuisances accompagnent forcément l’élévation du niveau de vie, comme la production de gaz carbonique par les automobiles, ou le volume toujours croissant de déchets ménagers, ne les inquiète pas : l’homme saura toujours trouver des solutions.
Entre ceux qui défendent la durabilité forte et ceux qui croient en la durabilité faible, il existe une véritable fracture idéologique. Pour les premiers, la décroissance, telle que l’a théorisée Nicholas Georgescu-Roegen (1), s’impose. Pour les seconds, le développement durable n’est que la sixième phase du développement tel que l’avait « chronologisé » Walt W. Rostow en 1960 dans un livre resté célèbre (2) : après les cinq étapes décrites par l’auteur (sociétés traditionnelles, conditions préalables au décollage, décollage, progrès vers la maturité, ère de la consommation de masse), survient l’ère du développement durable.
Les deux conceptions suscitent d’autant plus de questions qu’elles prétendent faire des choix au nom de tiers absents, les générations futures. Or on ne peut savoir avec certitude quels seront demain les besoins de l’humanité. En termes de demande énergétique par exemple : si l’énergie solaire devient l’énergie de demain, les énergies fossiles d’aujourd’hui, pétrole, gaz et charbon, ne seront plus utiles. Mais qui peut en être sûr ? De même, la notion de ressources renouvelables ou non renouvelables, qui fonde une grande partie du discours sur le développement durable, dépend du rythme de prélèvement et de la capacité de régénération du milieu : en cas de surpêche, la ressource halieutique des océans disparaît. Mais la notion d’irréversibilité elle-même dépend des techniques utilisées : on peut dépolluer une eau souillée, réintroduire artificiellement une biodiversité recréée. Ceux qui veulent sanctuariser la nature au nom de sa préservation oublient que tout écosystème est en perpétuel équilibre. Les sociétés humaines ont toujours été créatrices de biodiversité, chaque fois qu’elles l’estimaient nécessaires. Livré à lui-même, un milieu naturel s’appauvrit, colonisé par des espèces invasives, animales ou végétales (les broussailles et les épineux par exemple). Ainsi, pour la plupart des géographes, il n’existe pas de milieux dans l’œkoumène qui n’aient pas été anthropisés (c'est-à-dire transformés par l’homme) : cette nature que nous aimons tant est d’abord le fruit d’une construction sociale, le produit des choix effectués par les sociétés. Tout dépend des priorités qu’une civilisation se donne, et celles-ci changent selon le lieu et l’époque.
Mais justement, cette remarque pose la question de la gouvernance mondiale : qui décide des priorités ? La loi du marché ? Les plus puissants ? Ou des instances de régulation supranationales pouvant imposer l’intérêt supérieur des biens publics de l’humanité sur les intérêts particuliers de court terme ? Et qui n’existent pas encore, faisant courir le risque de prédations mettant à terme la survie de l’humanité elle-même en danger.