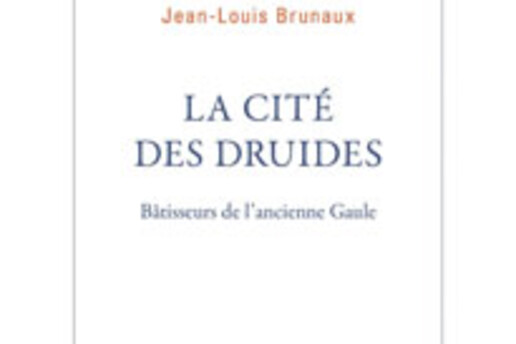Jürgen Habermas est le philosophe contemporain le plus lu, traduit et discuté à l’échelle internationale. Né en 1929 en Allemagne, il a été l’assistant de Theodor W. Adorno. Il est considéré comme l'héritier de la Théorie critique de la société, plus connue sous le nom d’école de Francfort (qui réunit notamment avant lui T.W. Adorno, Walter Benjamin, Marx Horkheimer et Herbert Marcuse). Théoricien de la modernité, influencé par le marxisme, il s’est intéressé aux conditions de l’émancipation sociale. Son œuvre de philosophie sociale est nourrie d’un dialogue avec d’autres disciplines (psychanalyse, sociologie, droit, théorie du langage…). Ancien directeur de l’institut Max-Planck de Starnberg, professeur émérite de la chaire de sociologie et d’histoire de la philosophie de l’université de Francfort, J. Habermas présente une œuvre prolifique, récompensée par le prix John-Werner-Kluge (équivalent du Nobel en philosophie). Connu surtout pour sa théorie de l’« agir communicationnel », Habermas a également mené des travaux sur la modernité, la théorie de la connaissance, l’espace public et la démocratie, le droit, la morale, la religion.
Il intervient souvent dans des débats publics comme en témoignent les 12 tomes de ses Petits écrits politiques.
À la suite de Theodor W. Adorno, Max Horkheimer et Herbert Marcuse, vous avez développé une théorie critique de la société. Votre idée de la théorie critique est-elle différente de la leur?
Vous mentionnez les trois philosophes qui ont fondé et développé la Théorie critique en publiant de grands essais originaux dans la Revue en recherche sociale 1. Cette revue fut publiée en exil (sauf la première année) entre 1932 et 1941, si bien que ses auteurs étaient pratiquement inconnus en Allemagne après la guerre. En 1944, Horkheimer et Adorno ont publié La Dialectique de la raison, qui offrait une analyse profondément pessimiste de l’effondrement moral d’une époque marquée par le fascisme et le stalinisme – et qui prenait déjà congé de la théorie critique des années 1930. Puis, les dix premières années suivant son retour en RFA, Adorno a fait connaître la tradition francfortoise tout en la réformant.
Initialement, la théorie critique de la société reliait Karl Marx à la critique de la bureaucratie de Max Weber. Elle était déjà bien moins adaptée à une analyse des crises que le marxisme classique. Cette théorie visait plutôt à expliquer la capacité tenace à l’autostabilisation du système qui se rétablissait toujours des crises qu’il générait. J’ai renoué avec la perspective de cette théorie des années 1930 dans le climat très différent des années 1950. À l’époque, nous étions frappés par la contradiction entre, d’un côté, les promesses normatives et le potentiel inépuisé des institutions démocratiques établies par les puissances victorieuses et, de l’autre, la continuité des élites dont l’esprit restait influent et qui avaient repris leurs anciennes fonctions. Les rares personnes de ma génération qui étaient de gauche ont perçu ce conflit politique palpable comme un défi lancé à un réformisme radical. À l’ombre de l’Holocauste, que la grande majorité de la population allemande avait violemment refoulé, il était néanmoins indéniable que, sur le plan politique, quelque chose de fondamental avait changé pour le mieux – précisément la promesse de la démocratie. Nous voulions remplir d’un contenu socialiste les procédures démocratiques, introduites d’abord en quelque sorte de manière formelle, dans l’Allemagne d’après-guerre, sous peu en pleine croissance économique. Il faut reconnaître rétrospectivement que les réformes de l’État social qui ont suivi ont été plus que nulles – et qu’à l’époque elles nous ont beaucoup déçus.
D’inspiration marxiste, l’école de Francfort menait des recherches sur les causes de la domination sociale. Cette thématique reste-t-elle le problème principal des sociétés occidentales ?
Dans le climat antistalinien de l’Institut en recherche sociale de Francfort et au contact d’Adorno (un esprit si nuancé), je m’écartais déjà, du temps de mon assistanat, de l’orthodoxie marxiste (qui rapportait tous les phénomènes sociaux pertinents aux impératifs de l’autovalorisation du capital). Mais je reste convaincu que la dynamique de modernisation de la société dans son ensemble ne peut s’expliquer sans faire référence aux causes systémiques persistantes de production d’inégalités sociales massives. Au début des années 1970, avant que le programme néolibéral s’impose, j’ai surtout examiné le déplacement discret de la dynamique de crise dans un essai intitulé Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé 2 – depuis le système de l’économie, les tendances à la crise se déplaçaient ensuite vers le système politique, dépassé par les problèmes de régulation, puis, face à la révolte culturelle des étudiants, vers les processus de socialisation, victimes d’une perte de sens. Depuis, avec le néolibéralisme, le noyau économique de la dynamique de crise est réapparu au grand jour. Aujourd’hui, je voudrais bien savoir si les politiques néokeynésiennes, imposées par la pandémie, annoncent la fin de la forme actuelle du néolibéralisme. Mais je ne suis pas économiste. En tout cas, nous vivons aujourd’hui une vague de régression politique ; pour la comprendre, il conviendrait de mener une analyse approfondie des causes sociales produisant des réactions de défense culturelles.