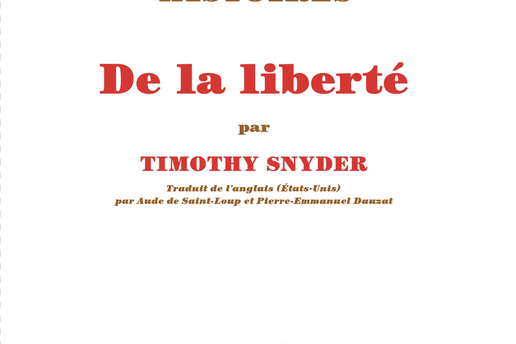À quel moment les questions mémorielles s’imposent-elles en France ?
Il est difficile d’en faire une généalogie linéaire. Ces questions mémorielles se sont plutôt construites par interactions entre de nombreuses dynamiques. On peut citer des logiques institutionnelles. Par exemple dans les années 1970-1980, le ministère des Anciens combattants réalise que ces derniers sont de moins en moins nombreux, ce qui remet en cause son existence même. Le ministère se renouvelle alors en travaillant de plus en plus sur la dimension culturelle, la mémoire, etc. La volonté des victimes de la Shoah, des anciens combattants ou des femmes victimes de violence d’obtenir la reconnaissance de ce qu’ils ont vécu a aussi joué un rôle important – c’est ce que Didier Fassin et Richard Rechtman ont décrit comme L’Empire du traumatisme (2007). Plus récemment, on peut souligner la néolibéralisation de nos sociétés qui invite à se concentrer sur l’individu, les émotions, la subjectivité, plutôt que sur les structures et le collectif.
Cette emprise des questions mémorielles a conduit à l’injonction au devoir de mémoire. Pour quel résultat ?
Le « devoir de mémoire » repose sur la croyance dans l’efficacité de la mémoire. C’est un champ qui est très investi, notamment par l’État, avec par exemple les visites scolaires à Auschwitz. Le devoir de mémoire reste ainsi une injonction permanente et, en même temps, nous sommes à un moment charnière à ce sujet : ce devoir de mémoire ne fonctionne pas nécessairement – l’éducation à la Shoah ne permet pas de faire disparaître l’antisémitisme par exemple. D’où notre livre, qui se veut une invitation à réfléchir à ces questions. Faut-il plus de mémoire ? De la mémoire autrement ? Devons-nous changer le contexte de la transmission ?