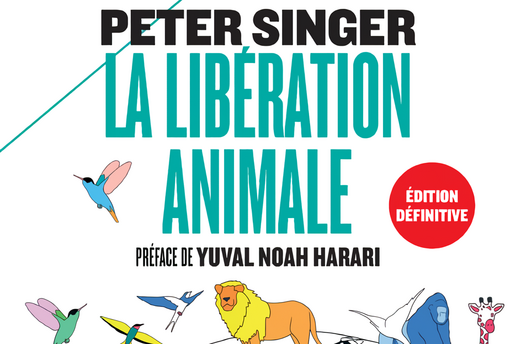Difficile d’imaginer un monde où les notions de bien et de mal n’auraient pas cours. Les mythes et les textes religieux contiennent tous une explication de l’origine du mal : le plus souvent, une erreur humaine. Juifs et chrétiens partagent la même histoire. La Bible prétend, en effet, que la morale nous est venue en deux fois. D’abord, c’est la honte qui saisit le premier homme et la première femme chassés du paradis. Puis c’est Moïse recevant les Tables de la Loi : « Tu ne tueras point », etc. Ces deux épisodes contiennent en germe l’essentiel du débat qui va nous occuper ici. D’où vient le sens moral ? Si l’on en croit la Genèse, du sentiment de la faute inscrit dans l’espèce humaine. Selon l’Exode, d’une poignée d’interdits tombés du ciel, et qu’il fallut apprendre à maintenir, génération après génération, contre la tentation de retomber dans l’impiété.
Aussi loin que la réflexion se porte, l’alternative existe : d’un côté, le sentiment spontané du bien et du mal, de l’autre, une conscience forgée par des croyances et des lois. Pour de nombreux philosophes grecs, le bien se confondait avec le bon. Pas vraiment de morale, donc, mais plutôt ce que l’on nomme aujourd’hui une éthique. Or cette éthique, souvent tournée contre les conventions et fuyant la souffrance, se voulait proche de la nature. Oui, mais laquelle ? Celle des sentiments ou celle de la raison ? On en débattra en particulier au XVIIIe siècle.
Quand la science s’en mêle
Faisons un saut dans le temps ! Aujourd’hui, le débat n’est pas seulement philosophique. La psychologie, l’éthologie et les sciences de l’évolution se sont saisies de la question. Ce qu’elles soulignent est loin d’être uniforme et conclusif, mais plaide pour une origine naturelle de notre sens moral.
En 1893, Thomas Huxley, le défenseur de Charles Darwin, professait que dans la nature ne se révélaient que méchanceté et indifférence. Depuis, les idées ont bien changé. Dès 1963, l’éthologiste Konrad Lorenz notait que l’existence de combats rituels chez certaines espèces animales dénotait un sens du « chevaleresque » et du « fair-play ». Mais c’est surtout l’essor des études sur les grands singes qui, depuis une quinzaine d’années, a popularisé l’idée que le sens moral ne leur est pas plus inconnu que la culture ou la communication. On a reconnu aujourd’hui de très nombreux cas d’altruisme dans les espèces animales : cela va des chauves-souris qui régurgitent une partie de leur repas au profit de leurs congénères affamés aux baleines qui se portent secours mutuel en cas de maladie ou d’attaque. Mais ce ne sont là que des comportements. Les sociétés d’insectes sont sans doute celles qui montrent le plus de comportements altruistes. Mais on leur attribue avec beaucoup de peine des sentiments ou des jugements moraux. Frans de Waal, auteur du Bon Singe (1997), ne doute pas en revanche de leur présence chez les primates, en particulier supérieurs, qu’il a observés. Que dire en effet des chimpanzés qui caressent leurs congénères malades ou blessés, tentent de calmer les adversaires, émettent des cris plaintifs, font le deuil de leurs morts en hurlant, si ce n’est qu’ils éprouvent de la sympathie, non seulement pour leurs petits mais pour leurs semblables en général ? Que penser également de ce jeune mâle battu par un autre qui, pendant des jours, fait mine de boiter devant lui ? Probablement qu’il cherche à attirer sa pitié. Ce qui signifierait qu’il sait que son congénère est capable de ressentir ce sentiment. Voilà qui est singulièrement humain.
Ainsi les actes de partage, de coopération, de réconciliation, de consolation, les gestes de protestation, d’indignation, de soumission ne seraient pas de simples réflexes de conservation, mais fondés sur des ébauches de sentiments moraux. L’idée d’une continuité sur ce plan entre l’animal et l’homme est un point de vue partagé aujourd’hui, conforté par des expériences récentes : Sarah Brosnan et F. de Waal, par exemple, ont observé des singes capucins. Si, pour une même performance, on leur attribue systématiquement des récompenses inégales, certains donnent ce que les chercheurs interprètent comme des « signes d’indignation ». Cela veut-il dire qu’ils éprouvent un sentiment d’injustice ? À voir…
Admettons que l’homme et les primates supérieurs naissent équipés de sentiments moraux. À quoi sont-ils bons ? Selon la théorie de l’évolution, ce qui est sélectionné doit présenter un avantage reproductif pour l’individu. Or, a priori, être disposé à se sacrifier, à coopérer ou à compatir représente plutôt un handicap. Un peu de gymnastique a donc été nécessaire pour imaginer non pas une mais plusieurs solutions à cette énigme. Premier temps : la notion de sélection de groupe (William Hamilton, 1964). Elle peut rendre compte des dispositions altruistes entre proches. En se sacrifiant à des apparentés, l’individu favorise la perpétuation d’une partie au moins de ses gènes. Cela explique par exemple que lorsqu’une ruche est attaquée, les abeilles ouvrières qui sont stériles se sacrifient au profit de la reine pondeuse. Le succès reproductif des abeilles « kamikazes » se vérifiera au niveau du groupe, pas de l’individu. Chez les humains, cela ne concerne que de petits groupes familiaux car le brassage génétique est plus grand.
Or la morale humaine ne s’adresse pas qu’aux parents proches. Un second mécanisme a donc été invoqué, l’altruisme réciproque, qui dit à peu près ceci : deux individus quelconques qui coopèrent de manière réitérée et équilibrée seront favorisés par rapport à ceux qui ne coopèrent pas. Le gène de la réciprocité (et celui du sentiment de gratitude qui va avec) se serait répandu ainsi au cours de l’évolution. Défaut du modèle : il ne s’applique qu’à des paires d’individus et n’explique pas comment la réciprocité devient une norme collective.