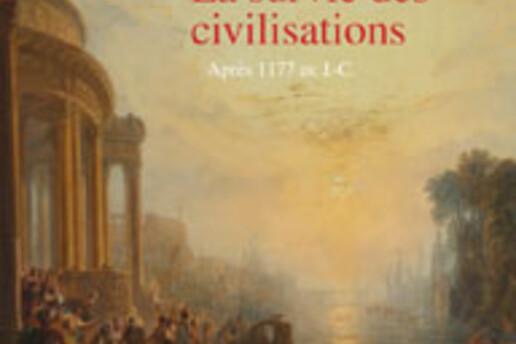Poser la question de la gouvernance globale revient le plus souvent à se demander si les instances administrant le système économique mondial sont à même d’affronter les enjeux de la mondialisation. L’OMC est-elle capable d’instaurer des règles commerciales compatibles avec les besoins des pays du Sud, ou bien n’agit-elle que dans l’intérêt des pays du Nord et de leurs firmes ? Le FMI œuvre-t-il à la stabilité monétaire internationale ou bien a-t-il pour principale mission de recouvrer les créances des prêteurs occidentaux ? Ces questions sont pertinentes. On aurait cependant tort de réduire les enjeux de la gouvernance globale à l’analyse des missions, des politiques et des insuffisances des institutions internationales.
Les prérogatives de l'État
Car ces dernières constituent en réalité des instances charnières. Elles administrent la « grande transformation » en cours, l’émergence du nouvel ordre global, bien plus qu’elles ne gouvernent ce nouvel ordre. Elles en seraient d’ailleurs, à mes yeux, bien incapables.
La gouvernance du nouvel ordre global se joue aujourd’hui dans la prolifération de systèmes transfrontaliers qui administrent un éventail croissant de processus, tant à l’intérieur qu’à travers les Etats-nations. A un bout de l’éventail, on repère des arrangements privés tels que le « lex constructions », un code mis au point par les leaders mondiaux de la construction civile afin de répondre au durcissement des standards environnementaux dans les cent principaux marchés nationaux où ils interviennent. A l’autre bout, on trouve le Tribunal pénal international (TPI), la première cour globale de tous les temps : à la différence d’une institution supranationale (qui ne s’occupe que des relations entre des Etats), elle possède en effet une juridiction universelle sur les pays signataires (ceux de leurs ressortissants qui auraient, par exemple, commis un crime contre l’humanité sont directement responsables devant le TPI). Entre les deux émerge une grande variété de systèmes transnationaux, comme ces réseaux d’acteurs publics et privés chargés de superviser des activités économiques particulières, telles que les télécommunications ou la finance internationale. Si l’on se fie aux décomptes les plus récents, il y aurait aujourd’hui plus de 125 systèmes transfrontaliers de ce type.
Cette prolifération ne signifie en aucun cas la fin des Etats nationaux. C’est plutôt comme si de petits bouts des gouvernances nationale et supranationale que l’on connaissait jusqu’ici se détachaient de leur support institutionnel existant (l’Etat-nation, les institutions supranationales) pour se réagencer au sein des nouvelles logiques organisationnelles de l’âge global. De fait, s’il est un champ au sein duquel ces nouveaux agencements globaux sont modelés, c’est bien celui du national et de l’Etat-nation lui-même. C’est là un fait largement ignoré dans les recherches sur la mondialisation où l’on a tendance à considérer que le national et le global sont deux entités mutuellement exclusives et en opposition l’une avec l’autre : la mondialisation ne pourrait se développer qu’aux dépens du national, et vice versa. Pourtant, certaines administrations étatiques s’avèrent essentielles au développement de l’activité des firmes globales, que ce soient les ministères des Finances, les banques centrales ou les agences gouvernementales de promotions des exportations. Ces instances publiques sont parties prenantes des infrastructures de la mondialisation et de sa gouvernance.
Cette évolution va de pair avec une relative dénationalisation de certaines institutions traditionnelles de l’Etat, dans le sens où une partie significative de l’action publique se détourne des projets nationaux pour s’investir dans la promotion de projets globaux, que ce soit la mise en forme d’un marché mondial du capital ou l’édification d’une justice pénale internationale. Les institutions étatiques concernées, plutôt que perdre de l’influence, en gagnent grâce à la mondialisation. Ce n’est bien sûr pas le cas de l’ensemble de l’Etat : le pouvoir législatif voit souvent ses prérogatives réduites à de strictes questions nationales, ayant de moins en moins de prise sur les enjeux globaux. Par exemple, les institutions supranationales telles que l’OMC et le FMI négocient seulement avec les exécutifs nationaux. Si l’on peut parler d’un déficit démocratique, c’est dans ce rééquilibrage des pouvoirs respectifs de l’exécutif et du législatif, aux dépens du second.