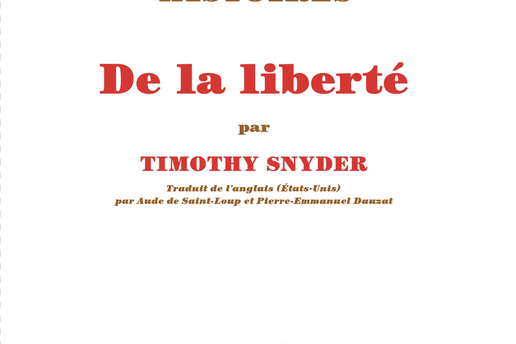A défaut de retenir la réponse, gardons le problème. Ce qui différencie l’action humaine d’un simple événement physique ou d’un comportement animal guidé par l’instinct, c’est bien l’idée que c’est le sujet agissant qui, par lui-même, est la source du mouvement. S’agit-il d’une illusion commune, fruit de l’ignorance des véritables causes qui nous font agir ? La question n’a cessé et ne cesse d’agiter encore les philosophes d’abord parce qu’elle revêt un enjeu moral de taille : si je ne suis pas à l’origine de mon action, je ne puis en être tenu pour responsable. Les conséquences ont de quoi faire frémir : aucune morale ne devient possible, aucune action n’est condamnable, nous ne sommes que les pantins d’un implacable destin.
Depuis quelques décennies, essentiellement parmi les penseurs anglo-saxons, le débat s’est déplacé pour donner lieu à une réflexion sur l’action proprement dite, moins dépendante d’une perspective morale ou politique qui tendait à obscurcir un problème déjà passablement compliqué. Ce débat assez technique s’appuie à la fois sur les apports de la philosophie du langage, de la logique mais aussi des sciences cognitives (voir les points de repère p. 40).
Causes ou raisons ?
Deux principaux courants s’affrontent. Le premier s’inscrit dans la réflexion ouverte par Ludwig Wittgenstein (notamment sa distinction entre les causes et les raisons) et poursuivie par Elizabeth Anscombe. Selon les tenants de cette approche, il ne faut pas chercher à expliquer l’action par des « causes » naturelles, et surtout pas rechercher ces dernières dans une intériorité fantasmée qui n’est qu’un mythe. Il serait beaucoup plus pertinent de comprendre l’action à partir de l’intention de l’agent, laquelle n’est pas une mystérieuse volonté intérieure, mais la raison d’agir, le but visé par l’action.L’autre courant, que l’on peut qualifier de « mentaliste », estime qu’il faut au contraire chercher à expliquer l’action par des causes, en particulier neurophysiologiques. Il veut inscrire l’action dans l’ordre de la nature comme tout autre phénomène. Il faut donc prendre acte des progrès scientifiques qui seuls pourraient éclairer définitivement ce que la métaphysique fumeuse tente d’appréhender depuis des siècles et des siècles. Cette perspective a le vent en poupe, en particulier avec l’essor des sciences cognitives. L’imagerie cérébrale apparaît alors pour beaucoup comme un outil capable de dévoiler les causes physiologiques de l’action.
Mais insérer l’action dans l’ordre causal de la nature ne revient-il pas à rendre impossible la liberté même que suppose l’action ? Autrement dit, les théories de l’action portées par les neurosciences ne risquent-elles pas de supprimer l’objet même qu’elles entendent expliquer ? Tel n’est pas l’avis de Joëlle Proust (voir l’article p. 42). S’appuyant sur certains travaux de neuropsychologie expérimentale, elle montre que l’analyse des phénomènes neurophysiologiques n’oblige pas à renoncer à la liberté de l’agent qui peut choisir entre différents modèles internes, lesquels sont autant d’anticipations de séquences d’actions possibles. Le règne de la causalité naturelle ne serait donc pas incompatible avec celui de la liberté.
Dans une perspective darwinienne, Daniel C. Dennett propose même de concilier liberté humaine et évolution (1). Penser que la liberté n’est pas une illusion et que l’esprit est le produit de l’évolution n’est guère contradictoire. Selon lui, le nombre de choix possibles dans une situation donnée augmente la capacité d’action d’un agent, même s’il se plie à certaines règles. Or la sélection naturelle a favorisé le développement d’organismes le plus à même de contrôler leurs environnements, naturel mais aussi cérébral. La liberté humaine est donc le fruit même de l’évolution.
Vincent Descombes, s’inspirant de L. Wittgenstein, refuse ce type d’approche (voir l’entretien p. 46). Préférant parler d’autonomie, il nourrit sa réflexion de l’apport de la sociologie et de l’anthropologie. Réticent vis-à-vis de la psychologie expérimentale, il met en effet l’accent sur le contexte social de l’action, laquelle n’est pas à comprendre à l’« intérieur », dans le cerveau, mais à l’extérieur, dans la société et la culture. Pour V. Descombes, l’autonomie de l’agent n’est surtout pas à rechercher dans l’absence de règles, contrairement à ce qu’un préjugé tenace laisse souvent penser. Au contraire, c’est dans l’espace des règles et des normes que la liberté humaine se dessine et prend forme.
Une plus grande autonomie ?
On le voit, quelle que soit l’optique adoptée, la liberté n’est plus incompréhensible surgissement, exception à l’ordre, fulgurance inexplicable. Elle n’est guère menacée par les règles et les normes.
Aujourd’hui, de nombreux travaux en sociologie mettent l’accent sur la réflexivité croissante des acteurs (voir l’article p. 50), entendez la faculté du sujet à réfléchir et à s’interroger sur ses choix de vie, qu’il s’agisse de la gestion des tâches domestiques ou de l’orientation professionnelle. Ce constat est en général corrélé à l’individualisation croissante de nos sociétés et au déclin des institutions qui encadraient les conduites. Le comportement du salarié ou de l’élève par exemple semble moins encadré dans des normes strictes. On fait appel à son autonomie, sa responsabilité, son initiative. Cette réflexivité va-t-elle de pair avec une plus grande autonomie des acteurs ? Il semble bien difficile de répondre. Si les choix possibles semblent plus nombreux, ils n’en obéissent pas moins à des règles qui leur donnent sens. Cette réflexivité constitue d’abord une injonction sociale : il faut un projet parental, un projet professionnel, gérer sa vie domestique, se construire… Preuve s’il en est que c’est bien le contexte social et ses règles qui dessinent aussi en creux notre autonomie.
Rien de plus naturel si l’on suit l’étymologie. L’« autonomie » (du grec « auto » et « nomos », loi) ne renvoie-t-elle pas au fait de se gouverner par ses propres règles ? Reste alors à définir ce en quoi ces règles sont miennes. Parce qu’elles sont le fruit de ma volonté ou parce qu’elles procèdent de moi en tant qu’être social appartenant à une communauté humaine ? Telle est pour l’heure la question.