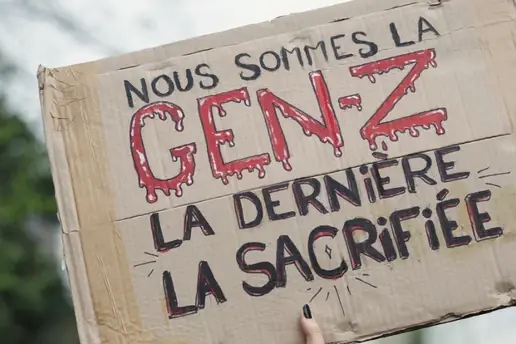« Les pays vont devoir faire un effort concerté pour renforcer leur rôle dans les domaines mettant en jeu les biens publics mondiaux, qu’il s’agisse de réduire le réchauffement planétaire (…), ou d’empêcher la destruction des ressources halieutiques mondiales. » Ce constat, tant de fois entendu et répété, provient cette fois de la Banque mondiale dans un rapport intitulé « Gérer la prochaine vague de la mondialisation », et rendu public en décembre 2006. Au rythme actuel, rappelle-t-elle, une hausse des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l’ordre de 50 % est prévue d’ici à 2030. Pour éviter que cela se produise, les politiques du monde entier devront promouvoir une croissance « propre ». Au-delà de la sempiternelle déclaration de principe, la Banque mondiale remet au centre du débat la croissance. Car c’est en effet autour d’elle que se focalise une grande partie de la réflexion sur le développement durable et son intégration ou non à l’économie mondiale. Et trois ensembles d’approches ouvrent des avenirs pour le moins différents à l’ensemble de la planète.
• L’approche néoclassique défend l’idée que les problèmes d’environnement ne peuvent se résoudre qu’avec plus de croissance. Il importe avant tout de transmettre aux générations futures une capacité à produire du bien-être économique au moins égale à celle des générations présentes. Ainsi, les théoriciens néoclassiques avance l’idée de « substituabilité » : la génération présente consomme du capital naturel et lègue aux générations futures davantage de capacités de production sous forme de stocks d’équipements, de connaissances et de compétences. Pour y parvenir, il faut dès aujourd’hui réinvestir les rentes de l’exploitation des ressources naturelles dans la recherche et l’innovation technologique via un système de taxation ou un fonds d’investissement spécifique. Il s’agit « d’internaliser des externalités ». Sous ce doux barbarisme se cache l’idée selon laquelle il faut donner une valeur marchande, un prix à ce qui jusqu’ici n’en avait pas – le vivant, les ressources naturelles, la pollution, etc. – afin d’obliger les acteurs économiques à prendre en compte le coût social de la détérioration de l’environnement.
• L’ecological economics récuse cette idée et affirme que les problèmes environnementaux sont irréductibles à la sphère marchande. Pour les tenants de ce courant, les ressources naturelles sont un capital qu’il faut absolument préserver. Il existe un stock de capital naturel minimum dont les générations futures ne sauraient se passer. Le principe semble simple, mais se pose alors le problème de la mise en œuvre. Comment identifier et mesurer les composantes de ce capital ? Comment en définir les limites d’exploitation ? Quelles institutions sauront réguler non seulement le capital naturel mais aussi arbitrer entre les différents acteurs en présence et apporter des réponses aux controverses scientifiques, aux débats politiques et aux enjeux industriels ?
• La décroissance. Ces questions, non encore résolues mais largement débattues notamment à propos de l’éventuelle création d’un organisme mondial de l’environnement, paraissent avoir peu d’intérêt aux yeux des théoriciens de la décroissance. Ceux-ci rejettent l’idée même de développement au motif qu’il est le masque derrière lequel avance l’occidentalisation et la marchandisation du monde. De plus, selon eux, nombre de politiques environnementales ne feraient qu’aviver les tensions Nord/Sud. En effet, en instaurant des droits à polluer et un commerce des gènes dans le cadre de la lutte contre l’érosion de la biodiversité, les pays du Sud partiraient perdants. Au regard du rapport de force politique, ils seraient contraints de vendre leurs droits à bas prix.
D’où la décroissance conviviale prônée notamment par l’économiste Serge Latouche, qui n’est pas sans rappeler l’austérité joyeuse d’Ivan Illich. Une société où les besoins sont réduits mais où la vie sociale est nettement plus riche. Bref un programme pour penser un après-capitalisme.
Comment rendre le développement durable ?
Si le développement durable s’impose sur les agendas politiques, une question demeure : comment le rendre opérationnel ?
Trois théories économiques s’opposent à ce sujet.
Trois théories économiques s’opposent à ce sujet.