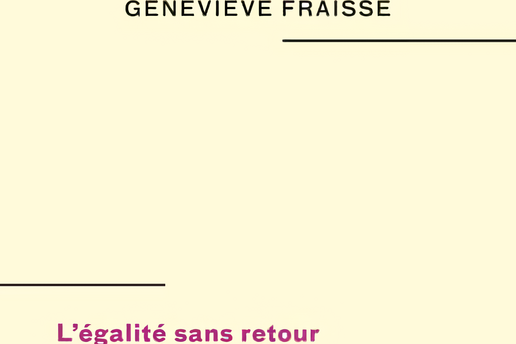En octobre 1946, à 18 ans, vous entrez à la Sorbonne comme étudiante en histoire. Quelle est la place est accordée aux femmes dans le contenu de l’enseignement ?
Quand je suis arrivée à la Sorbonne, où d’ailleurs n’enseignaient que des hommes, l’histoire des femmes n’existait absolument pas. Ce qui régnait, c’était l’histoire économique et sociale enseignée par Ernest Labrousse. Cela m’a beaucoup séduit d’ailleurs. D’abord parce que c’était le front pionnier à cette époque, c’était « up to date ». D’autre part, sur le plan politique, E. Labrousse parlait des ouvriers, du socialisme, etc. Je ne viens pas du tout de ce milieu-là, mais c’était dans l’air du temps. J’étais d’ailleurs fascinée par la philosophe Simone Weil, qui avait travaillé en 1937 dans les usines Citroën. Enfin, cette histoire se présentait avec une grande volonté scientifique. Il fallait compter, numériser puis condenser l’ensemble dans des statistiques. Le modèle, c’était les sciences dures.
La question féminine vous intéressait-elle déjà ?
Oui, tout à fait. J’ai été scolarisé dans un collège catholique, le cours Bossuet, pour faire plaisir à ma grand-mère. L’une de mes professeures a été Benoîte Groult. Elle n’en avait pas du tout gardé souvenir, mais moi, si. Il y avait aussi des jeunes filles des Jeunesses étudiantes chrétiennes féminines. Elles étaient très mal vues, mais je les trouvais séduisantes, modernes, délurées ! Et Simone de Beauvoir était pour moi fondamentale, par son exemple et sa vie avant même de l’être par ses écrits. Je la voyais vivre, c’était une femme en mouvement, une femme qui conduit sa voiture, qui voyage, qui n’a peur de rien en définitive… sauf de la maternité peut-être. C’était une femme extraordinaire.
Mais quand j’ai proposé à E. Labrousse de choisir un sujet de recherche sur les femmes, il ne m’a pas prise au sérieux. Pourtant il était aussi féministe qu’on pouvait l’être à cette époque-là. C’est lui qui m’a recrutée. Et il recrutait d’autres femmes : il est probablement pionnier dans ce domaine. Donc ce n’était pas un refus, mais plutôt un manque d’intérêt : à ses yeux, les femmes étaient des hommes comme les autres…
Votre thèse d’État porte donc sur le monde ouvrier et non sur les femmes
Oui, ma thèse a porté sur les ouvriers en grève de 1871 à 1890. Il y a quelques pages sur les femmes, mais peu, tout simplement parce qu’il n’y avait pas beaucoup de grèves de femmes. D’abord, elles étaient moins nombreuses que les hommes dans l’industrie. Par ailleurs, cela venait aussi des sources qui étaient trompeuses : le « ils » des archives dissimulait souvent des hommes et des femmes. Mon intérêt pour les femmes s’est développé plutôt après 1968. J’ai en effet soutenu ma thèse en 1971. J’étais à ce moment-là maîtresse de conférences à l’université Paris-VII (Jussieu) et je participais au MLF. Jussieu était centre d’organisation des manifs : pour la contraception, pour l’avortement, pour l’expression des femmes, etc. C’est là où les choses ont changé. Je me disais : « Je milite, je revendique, mais au fond, dans l’enseignement et la recherche, qu’est-ce que je fais pour les femmes ? » C’est ce hiatus entre l’engagement militant, « ce mouvement vivant, contestataire », et l’absence, le silence des femmes dans l’histoire, qui m’y a amenée. J’avais toujours été préoccupée des femmes, des modèles féminins, mais là c’était un peu comme une brèche qui s’ouvrait, et qui permettait à une question latente de s’expliciter.